Des voix fortes commencent à se faire entendre, qui ciblent la responsabilité des économistes, interrogent la fiabilité de leurs analyses, la part d’idéologie dans la théorie. Pourquoi ont-ils affirmé depuis vingt-cinq ans qu’il n’était pas nécessaire de réguler la finance, qu’il suffit, pour assurer une croissance durable, d’avoir une faible inflation sur les marchés des biens, sans se préoccuper de l’évolution du prix des actifs (immobilier, actions etc.) ? Pour Joseph Stiglitz, qui fut directeur de la Banque Mondiale, la théorie économique est devenue un monde autosuffisant, une fausse représentation de la réalité. Il met en cause tout à la fois le rôle de l’outil mathématique et les présupposés libéraux qui ont « conduit la science économique à passer du statut de discipline scientifique à celui de supporter le plus enthousiaste du capitalisme de libre marché. »1
Les économistes ont misé sur les modèles simples de concurrence parfaite. Ces modèles ont un degré de sophistication qui leur donne une image de sérieux alors qu’ils se limitent aux conditions qui permettent d’aboutir à un résul-tat. Cependant, note Stiglitz, « une bonne partie des erreurs d’analyse de la théorie dominante ne provient pas d’un manque de sophistication mais d’hypothèses fausses ». D’où proviennent ces hypothèses ? Constatant que l’économie se heurte aujourd’hui au mur de l’orthodoxie néolibérale mise en place, dans les années 1980, autour de Friedrich von Hayek et de Milton Friedman, puis relayée idéologiquement et politiquement par Margaret Thatcher et Ronald Reagan, René Passet2-3 nous invite à replacer l’évolution de la science économique dans celle, plus générale, des connaissances et de la vision qu’elles donnent globalement du monde.
La théorie économique dominante actuelle se fonde sur des conceptions dépassées : rationalité des agents économiques, neutralité de la monnaie, foi inébranlable dans la régulation du marché. Elle tourne diamétralement le dos aux avancées scientifiques de notre temps que sont la complexité, le réseau, l’incertitude.
Il s’agit là d’une formidable régression. Dans sa grande fresque historique, fruit d’un travail de réflexion pluridisciplinaire, René Passet décrit les étapes successives de cette histoire parallèle de la conception du monde et de celle de l’économie. La vision mécanique de Newton inspire celle des économistes, tel David Ricardo, qui imaginent un système dont l’intérêt privé constitue le ressort, et la concurrence le moteur. On connaît la célèbre « main invisible » d’Adam Smith qui transforme spontanément les intérêts individuels en intérêt général.
Il existe une loi « gravitationnelle » des prix : l’offre et la demande ramènent mécaniquement le prix du marché
à son niveau « naturel ». La découverte de l’énergie et des lois de la thermodynamique, qui décrivent la transformation de la chaleur en mouvement (par Sadi Carnot), bouleverse Les grandes représentations du monde de l’économie.
2éd. LLL – Les liens qui libèrent,2010.
3Interview dans le n° du 25 octobre 2010 de
Télérama dont des éléments sont repris ici.
Cette vision d’un monde « horloger » est à la base de la révolution industrielle et d’un nouveau regard sur le monde qui rompt avec l’image de l’équilibre et de la répétition : le monde évolue, comme va aussi le montrer Darwin. La théorie économique suit le pas. À la loi de la conservation – une fois brûlé, le charbon existe encore à l’état de gaz et de cendres -, correspond l’idée d’une permanence malgré tout : c’est la conception de l’ « équilibre général » des marchés de Léon Walras (1834-1910), l’équilibre de chaque marché dépendant de celui de tous les autres.
La loi de la dégradation (une fois brûlé, le charbon ne pourra plus engendrer le mouvement) suggère que l’Univers marche vers la mort thermique. Marx (1818-1883) et Engels (1820-1895), également influencés par la pensée de Hegel, pour qui l’Univers évolue selon un processus de continuel dépassement, s’en inspireront pour décrire l’autodestruction du système capitaliste. Puis apparaît au niveau de l’infiniment grand le monde de la relativité, révélé par Einstein, et au niveau de l’infiniment petit la mécanique quantique qui bouleverse la vision de la réalité. À cette même époque, Freud dévoile les profondeurs de l’inconscient humain. C’est dans ce cadre nouveau que John Maynard Keynes (1883-1946) construit son oeuvre en relativisant la théorie économique classique comme Einstein a relativisé l’univers newtonien.
Ainsi, comme Einstein intégrait le temps et l’espace dans un concept unique d’espace-temps, Keynes intègre la monnaie, porteuse de temps, à l’espace de l’économie réelle alors que les classiques la tenaient à l’écart, la considérant comme neutre. Keynes s’inspire aussi de Freud pour établir les fondements psychanalytiques des comportements individuels et, au niveau collectif, ceux des marchés. Au présupposé classique de la rationalité des marchés, qui évacuaient l’imperfection des connaissances et des comportements humains, il oppose l’incertitude dans laquelle les acteurs économiques sont condamnés à agir.
Aujourd’hui, l’esprit humain est entré dans le champ économique en tant que facteur de production, au même titre que le capital ou la force musculaire. L’information s’étend désormais à tous les aspects de l’activité humaine. Et elle fonctionne en réseau à l’échelle du monde. C’est désormais dans ce cadre que s’organise la vie économique. Parallèlement, notre regard sur l’Univers a de nouveau changé. Les anciennes conceptions butaient sur la question de la vie. Comment aurait-elle pu jaillir du monde « horloger », au mouvement éternellement recommencé, ou de celui marchant irrémédiablement vers sa dégradation ? Si la vie est apparue, c’est qu’il y a dans ce monde des forces et des énergies qui la conduisent à se complexifier sans cesse, du big bang au cerveau humain. C’est cet univers complexe qu’il s’agit aujourd’hui de décrypter.
Les ordinateurs permettent des calculs qui révèlent des phénomènes jusqu’ici inaccessibles à la connaissance : nouvelles théories dites du chaos, celle des «structures dissipatives» d’Ilya Prigogine ou des « catastrophes » du mathématicien René Thom. La pensée économique n’est pas restée à l’écart de ce mouvement. Des auteurs se sont attachés – et s’attachent – à la faire progresser, tel Joseph Schumpeter (1883-1950) qui a développé le concept de « destruction créatrice » du capitalisme qui détruit ses éléments vieillis en en créant continuellement de nouveaux. On voit le parallèle avec un univers qui se dégrade en engendrant un monde de plus en plus complexe. Ces travaux n’ont pas encore débouché sur une nouvelle synthèse.
La conclusion est forte : il ne faut jamais juger les auteurs en dehors de leur époque. Ricardo, qui vivait au XlXème siècle en Angleterre, au début du capitalisme, eut raison d’insister sur la vertu de l’épargne : ce qui manquait alors, c’était le capital, moteur du développement. En revanche, un peu plus d’un siècle plus tard, Keynes eut tout aussi raison de préconiser l’inverse, c’est-à-dire de dépenser. L’accumulation primitive du capital étant réalisée, la consommation était devenue le moteur de l’économie. L’essentiel est donc de ne pas se tromper d’époque. Et c’est ce que font aujourd’hui les néolibéraux.
Lucienne Gouguenheim
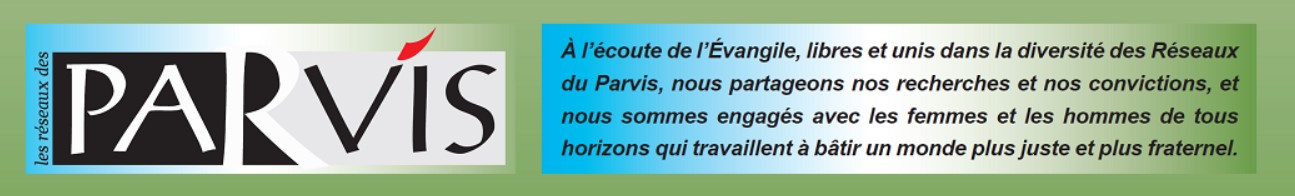
Laisser un commentaire