Vastes problèmes et déontologie personnelle
L’article qui suit est une mine d’informations sur la terre et l’eau ; certaines ont de quoi inquiéter.
Ainsi l’affirmation que les limites de notre planète en terre agricoles et en eau seront bientôt atteintes. L’auteur nous projette dans la décennie à venir et termine par la question : que faire ?
La sobriété heureuse est une des réponses possibles à cette question, elle n’exclut pas, bien au contraire, les autres réponses suggérées dans le précédent article.
Usage et usure des sols
Une prise de conscience récente
On a longtemps pensé que les capacités de notre planète à nourrir convenablement toute sa population et à lui procurer les matières premières nécessaires à son existence n’avaient pas de limites physiques, ou qu’à tout le moins ce serait le problème qui se poserait à des générations loin dans le futur, aidées en cela par les inéluctables progrès techniques qui ne manqueraient pas de surgir entre-temps.
Comme on le sait maintenant à coup sûr, il n’en est rien. C’est nous qui découvrons, alors que le temps presse, que les limites de notre planète à produire des terres agricoles et à fournir l’eau nécessaire à ces terres vont être atteintes prochainement. Plus inquiétant, une personnalité comme Jacques Blamont, membre de l’Académie des Sciences, et ancien directeur scientifique du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), estime que « toute progression de la technique entraînera l’amplification de la consommation », donc des pénuries et des conflits. On serait donc en train d’entrer dans une spirale infernale, amorce d’une catastrophe du genre humain.
Notre planète
Dans l’univers, la Terre semble bénéficier d’une situation favorable unique.
Là où l’eau se trouve sur d’autres planètes sous forme de vapeur ou sous forme de glace, nous avons à notre disposition une planète dont les températures sont presque toujours comprises entre 0 et 100°C, c’est-à-dire que nous disposons d’eau sous forme liquide. Mieux encore, la roche qui constitue la croûte subit de ce fait l’action de l’eau (gel, dégel, érosion), ainsi d’ailleurs que l’action de l’air (oxygène, gaz carbonique). La roche subit en conséquence des désagrégations propices à la croissance de végétaux, rudimentaires au départ comme les algues microscopiques, puis de plus en plus complexes, les débris des végétaux morts favorisant à leur tour le développement de leurs successeurs. Ce substrat engendre la prolifération des microbes qui concourent à la rendre fertile, puis des vers etc. Au terme de plusieurs milliers d’années, la roche est sur quelques décimètres d’épaisseur l’humus qui, avec les particules inertes d’argile, constitue la terre arable. Il est symptomatique que l’on désigne par le même mot « terre » le sol que l’on laboure, la boule de glaise que l’on pétrit et la planète elle-même sur laquelle nous vivons.
La Terre est la seule planète qui ait un sol, et toute la vie, y compris nous-mêmes, provient de se sol.
La situation actuelle
Les terres agricoles
Pendant des millénaires, la faible population humaine s’est accommodée de la chasse et de la cueillette pour subsister.
Ce sont les premières civilisations agricoles, il y a 8 000 ans, qui ont à la fois permis de nourrir une population plus nombreuse et introduit, si l’on ose dire, l’érosion, conséquence d’une domestication mal contrôlée. En ruinant ainsi la terre par de mauvaises pratiques, l’agriculteur a provoqué les premières famines. Au fil des siècles, l’homme a pris conscience qu’il ne fallait demander à la terre que ce qu’elle pouvait fournir sans l’user. De longues périodes de stabilité ont existé dans les civilisations quand on a pu vivre en bonne intelligence avec le sol. Comme le racontent les microbiologistes des sols Lydia et Claude Bourguignon, les sols des pays méditerranéens ont été progressivement épuisés par la culture du blé mal maîtrisée, ce qui a conduit à les consacrer à des céréales moins difficiles, comme le seigle, puis aux arbres fruitiers (amandiers et oliviers) encore moins exigeants, jusqu’à la vigne, étape ultime que l’on atteint quand le sol ne peut plus rien porter.
Dans le même registre, certains pensent que la disparition de la civilisation de l’Ile de Pâques a pour cause une utilisation abusive des forêts pour le chauffage et la construction.
Au XIXe siècle, la France atteint un équilibre entre son environnement ses besoins. C’est au tournant de ce siècle qu’apparaît la chimie qui ambitionne de révolutionner le labourage et le pastourage chers à Sully. C’est alors également que les consommations frugales de la population française, essentiellement rurale, explosent, notamment du fait d’une consommation carnée de plus en plus importante. C’est alors enfin qu’on développe des herbicides, des insecticides et des fongicides dont la vocation est de détruire respectivement la flore, les insectes et les bactéries que l’humus recèle en grandes quantités et dont la disparition conduit à la stérilisation progressive des terres agricoles.
L’agriculteur était jusqu’à présent le protecteur naturel du sol qu’il cultivait.
Désormais, le sol n’est plus sa préoccupation : il se conforme aux directives des sociétés qui lui fournissent les engrais industriels pour nourrir les plantes et les produits phytosanitaires pour les badigeonner. On préfère ignorer l’épuisement progressif des terres soumises à ces agressions chimiques tout comme la disparition de 50 % des oiseaux en Europe au cours de 30 dernières années.
Nous consommons en France de l’ordre de 400 kg de céréales par habitant et par an. Il s’agit de l’ensemble des céréales, celles que nous consommons directement, sous forme de pain par exemple, ainsi que celles qui ont été nécessaires à la production de nos aliments carnés.
Généralisées à toute la planète, une telle moyenne permettrait de nourrir trois milliards d’habitants, moins de 50 % de la population actuelle. Heureusement, si l’on peut dire, des pays comme l’Inde se limitent à 200 kg par an, moyenne que ce pays obtient avec une alimentation à base de riz agrémentée de viande une fois par mois !
Or, malgré des mises en garde, heureusement de plus en plus écoutées, malgré l’essor récent, hélas insuffisant, d’une agriculture respectueuse de l’environnement, l’agriculture dite moderne n’a toujours en tête qu’une augmentation de sa production et de sa productivité.
Maïs, soja et sorgho arrivent chaque année par millions de tonnes dans les ports européens en provenance d’Argentine et du Brésil pour nourrir nos poulets, porcs et bovins. Les logiques financières à court terme des banques agricoles et des circuits puissants d’approvisionnement en produits alimentaires ont évacue le souci à long terme de gestion de l’environnement.
Il faut ajouter à cette dégradation des sols arables les stérilisations importantes de sols agricoles pour accueillir les extensions urbaines, les routes et autoroutes, les zones d’activités particulièrement gourmandes en sols voués ensuite à l’imperméabilisation. Le paysan traditionnel limitait au strict minimum ses besoins en surface pour se loger, lui et ses animaux et stocker sa récolte, afin de consacrer aux cultures le plus possibles des faibles surfaces dont il disposait.
Maintenant, l’homme urbain devenu majoritaire dans la société, totalement déconnecté des préoccupations de ses ancêtres, rêve surtout d’un pavillon séparé de celui de son voisin, sur une parcelle où il pourra cultiver à loisir un gazon bien vert. La prise de conscience de ce gâchis se fait fort heureusement depuis quelque temps et on peut espérer que les plans d’urbanisme, comme c’est le cas dans plusieurs communes, imposeront une utilisation raisonnée des sols agricoles.
Enfin, nouvelle aventure pour l’agriculture, devant la fin plus ou moins prochaine des hydrocarbures extraits de la terre, « on » lui demande de participer à l’élaboration de biocarburants en y consacrant des surfaces importantes.
C’est d’ores et déjà le cas aux Etats-Unis où encore la moitié du maïs sert à fabriquer de l’éthanol, ce qui a entraîné il y a quelques années une montée des prix de la graine, déclenchant des émeutes dans le pays voisin, le Mexique, où le maïs est la nourriture de base de la majorité de la population.
L’eau
Si l’on se place maintenant du côté de l’usage de l’eau, on doit au préalable faire la distinction entre eau consommée et eau prélevée. Le plus souvent, l’eau prélevée pour les besoins domestiques, les usines hydroélectriques, les industries, est rejetée en majeure partie dans le milieu naturel, à l’exception d’une faible part qui s’évapore, de l’ordre de 10 %. En revanche, l’eau prélevée pour l’irrigation est véritablement consommée pour l’essentiel car elle est ensuite transpirée par la végétation, à hauteur de 70 %. Il en est de même pour l’eau de l’agriculture pluviale qui est entièrement évaporée. Il en résulte que l’agriculture, qui prélève globalement 66 % du total des prélèvements, est encore plus en tête du classement pour la consommation : 96 % de l’eau consommée est à usage agricole, soit 4 % pour les autres consommations, dont l’eau potable. Ce résultat peut sembler paradoxal parce que l’on est plus facilement frappé par des scènes de manques d’eau potable que par des sécheresses affectant les récoltes.
La généralisation de l’eau potable pour tous est un objectif que l’on pourrait atteindre en quelques années : il suffirait d’y consacrer un effort financier ridicule par rapport aux budgets militaires de la planète. En revanche, l’augmentation des ressources en eau nécessaires à l’agriculture, donc à la survie des humains, demande des investissements autrement plus importants. Notre vision est faussée également parce que nous habitons une région dans laquelle les sols arables et l’eau sont abondants et parce que les efforts à faire pour reconquérir la qualité des uns et de l’autre apparaissent somme toute la portée d’un pays comme le nôtre, riche en expertise et en capacités de réalisation.
Le tableau en page précédente appelle un certain nombre de commentaires.
Le riz exige des quantités d’eau importantes. Ce qui explique que lorsque l’eau n’est pas abondante, on doive se contenter d’une seule récolte par an avec l’eau de la mousson tandis que lorsque l’on dispose d’eau en abondance, on peut faire deux, voire trois récoltes par an. Ce qui montre également l’intérêt de la recherche agronomique pour mettre au point des variétés de riz moins gourmandes en eau.
Le blé demande lui aussi beaucoup d’eau, plus que le maïs pourtant réputé pour ses besoins. Le paradoxe n’est qu’apparent : le blé a besoin d’eau pour sa croissance, c’est-à-dire sous nos climats durant l’hiver et surtout le printemps, période où la pluviométrie est favorable. Quand la croissance est achevée et jusqu’à la moisson, les disparaissent. En revanche, pour le maïs, plante d’origine tropicale, les besoins liés à la croissance se situent en été, période pluvieuse en zone tropicale Nord, malheureusement période sèche en Europe. Il faut donc, en puisant dans des cours d’eau au plus bas de leur débit à cette période et à l’aide d’asperseurs parfois gigantesques, fabriquer des pluies tropicales artificielles !
On constate également les 13 m3 d’eau nécessaires à l’obtention d’un kilo de boeuf, soit 13 fois plus que pour 1 kg de blé. Quant aux produits maraîchers et aux pommes de terre, ils apparaissent comme peu gourmands en eau, surtout comparés aux produits carnés.
Comme on le sait, l’eau est très mal répartie sur la planète, à la fois géographiquement (régions humides, régions sèches) et dans le temps (inondations, sécheresses). Partout où il s’est installé, l’homme à cherché à s’assurer prioritairement la disponibilité de l’eau pour ses besoins. Les civilisations sont véritablement nées de la présence d’eau en abondance : le Nil en Egypte, le Tigre et l’Euphrate au Moyen-Orient. Quelques milliers d’années plus tard, l’Egypte, même après la réalisation du barrage d’Assouan, sait que sa ressource historique est menacée par les besoins des pays en amont, le Soudan et surtout l’Ethiopie. L’Irak et la Syrie sont de leur côté confrontés aux immenses investissements en barrages que fait la Turquie pour mettre en valeur sa région sud-est. Quant à l’ex-URSS qui jugé bon de détourner deux grands fleuves de l’Asie Centrale, l’Amou Daria et le Syr Daria pour produire notamment du coton dans les steppes de l’Asie centrale, ses successeurs doivent faire face aux conséquences néfastes de ces investissements gigantesques : disparition presque totale de la mer d’Aral où aboutissent ces fleuves, pollution, disparition des poissons.
Plusieurs pays puisent délibérément dans les eaux souterraines à un rythme très supérieur à celui de leur reconstitution. Aux Etats-Unis par exemple, en Arizona, on pompe plus 400 millions de m3 par an alors que les nappes ne se rechargent qu’à raison de 200 millions de m3 ; dans les Hautes Plaines du pays, on a désormais consommé 20 % de la réserve. Les prélèvements excessifs dans la région de Madras en Inde ont eu pour effet la salinisation des nappes par l’eau de mer jusqu’à 10 km de la côte. Plus près de nous, et nous en sommes bon gré mal gré les acteurs, la région sud-est de l’Espagne s’est convertis à l’agrumiculture et au maraîchage intensif pour devenir le premier fournisseur de l’Europe en la matière. Les nappes des vallées étaient, jusqu’à il y a peu, sollicitées par des prélèvements inférieurs aux apports des cours d’eau. Maintenant les prélèvements dépassent de très loin les apports. On va donc lucidement vers la ruine de l’agriculture de cette région.
Plusieurs pays puisent délibérément dans leurs eaux souterraines à un rythme très supérieur
à celui de leur reconstitution.
Les décennies à venir
Si l’on se place aux alentours de 2050, l’hypothèse communément admise est celle d’une population de 9 milliards d’habitants. Les prévisions climatiques sont généralement assez pessimistes, l’augmentation inexorable, dans la situation géopolitique actuelle, du taux de gaz carbonique dans l’atmosphère conduisant à des dérèglements climatiques certains, même si leur localisation et leur importance sont difficiles à apprécier. L’amélioration prévisible et souhaitable de l’alimentation des terriens sous-alimentés actuellement amène à comparer les ressources dont actuellement amène à comparer les ressources dont nous disposerons alors en terres arables et en eau aux besoins en denrées alimentaires qu’il faudra produire.
Même si de telles extrapolations sont hasardeuses, on aboutit à un résultat très inquiétant.
Notre planète aura toutes les peines du monde à nourrir ses enfants. En matière d’eau, les besoins physiologiques étant assurés sans problème, les besoins pour l’agriculture devraient pouvoir l’être aussi. Il y a des contraintes à cela. Notre planète n’aura jamais assez d’eau pour nourrir neuf milliards d’êtres humains qui consommeraient de la viande au rythme actuel des habitants des pays riches, sans parler du fait qu’une surconsommation en calories conduit à l’obésité : il s’agit donc également d’un problème grandissant de sa santé publique.
Ce sont les terres agricoles qui risquent de faire défaut. Certains pays l’ont compris, qui cherchent d’ores et déjà à se procurer des terres arables dans des pays étrangers afin d’assurer la production alimentaire actuelle et surtout future de leur population (Corée du Sud, Chine, monarchies du Moyen-Orient).
Il faudra limiter la production des biocarburants qui utilisent des terres agricoles au détriment des productions alimentaires. Qui arbitrera entre l’un ou l’autre ? Le marché comme on dit ou une instance internationale ?
Il faudra limiter l’utilisation pour l’agriculture des surfaces protégées, ce que l’on appelle les écosystèmes, qui représentent 2,5 milliards d’hectares actuellement. Les scénarios actuels prévoient qu’il faudra les utiliser en partie pour la production alimentaire, ce qui les ramènerait à 1,6 milliards d’hectares, et 1 milliard d’hectares si on consacrait 600 millions d’hectares à la production de biocarburants, ce qui ne couvrirait en fait qu’un faible pourcentage des besoins énergétiques à cette échéance. Des défrichements gigantesques sont déjà en cours : en Amazonie, à Sumatra, pour des productions de biocarburants ou d’oléagineux. La poursuite inexorable de ces défrichements peut, à juste titre, nous faire frémir.
Une activité humaine nouvelle surgit en ce moment : le recours aux huiles et au gaz de schistes. Cela risque de réduire à néant les décisions sages qui sont prises depuis quelque temps en faveur des énergies renouvelables respectueuses de l’environnement. On espérait que ces dernières seraient rapidement compétitives devant les hydrocarbures en début d’extinction et donc condamnés à un renchérissement. Or, les gaz de schistes remettent en question ce scénario. Si certains pays, notamment européens, ont renoncé jusqu’à ce jour à les utiliser, à cause principalement de leurs effets destructeurs sur l’environnement, d’autres nations comme les Etats-Unis et le Canada y recourent délibérément. Pour les Etats-Unis, il s’agit de profiter de cette nouvelle ressource énergétique pour retrouver dans ce domaine une autonomie perdue depuis quelques décennies. Il y a là sans doute une justification à leur faible implication au récent Congrès de Rio. Quant au Canada, il a déjà manifesté sa position en se retirant en décembre dernier du Protocole de Kyoto.
Cette nouvelle donne bouleverse les hypothèses qui misaient sur un début de sagesse des Etats. Va-t-on recommencer un cycle de prélèvements destructeurs de l’environnement et de la biodiversité avec une énergie à nouveau bon marché ? Quelles en seront les conséquences, à priori défavorables pour le climat, donc pour les potentialités agronomiques des terres arables ?
Nous savions qu’on entrait dans une période difficile avec des choix cruciaux à faire. L’avenir devient plus compliqué à appréhender. Les Etats se rétractent sur leurs intérêts immédiats, les nantis ne voient pas au nom de quoi ils devraient diminuer leur niveau alimentaire, voire leurs gaspillages, les classes moyennes qui émergent dans leurs pays en développement rapide ne rêvent que de goûter à leur tour aux modes de vie des pays très développés et n’admettraient pas qu’ils ne puissent plus y accéder.
Comment s’en sortir ?
Quel mécanisme international pourra nous ramener à la raison ? Pourra-t-on limiter les défrichements et maintenir la biodiversité que nous nous arrogeons le droit de faire disparaître alors que nous en faisons partie ? Va-t-on répéter, à l’échelle de la planète cette fois, la catastrophe qui a vu la disparition de l’espèce humaine sur l’île de Pâques ? Une fraction de l’humanité va-t-elle envisager la disparition d’une autre fraction au prétexte qu’il n’y a plus assez de terres pour tout le monde ?
Les hommes ont pu, dans certaines conditions, s’organiser pour mettre fin à une pollution mondiale. Le graphique ci-contre concerne l’évolution d’une substance entre 1800 et nos jours. On voit sur le graphique qu’elle a crû rapidement jusqu’en 1970, date à partir de laquelle elle a décru encore plus rapidement jusqu’à disparaître pratiquement.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit du plomb que l’on mesure dans les neiges et les glaces du Groënland.
Ce plomb provenait essentiellement des carburants additionnés de plomb durant de longues années. Sous la pression des écologistes, l’essence sans plomb s’est imposée et la diminution du plomb dans l’air a été immédiate.
Même si l’on doit se réjouir d’un tel exemple, il est certain que le succès de la disparition de la pollution au plomb ne peut se répéter aussi facilement quand il s’agit de toutes les terres arables.
Que pouvons-nous faire ?
A notre niveau individuel, il faut adopter une vie plus frugale, s’informer de la provenance proche ou lointaine des aliments que nous achetons, de la manière dont ils sont produits et commercialisés. Faire des choix en conséquence, expliquer autour de nous les raisons de nos choix quand l’occasion se présente, surtout auprès des jeunes qui sont les plus réceptifs à ces problèmes et donc les plus aptes à généraliser des pratiques plus vertueuses, militer quand c’est possible dans les associations qui font prendre conscience des dangers écologiques qui nous menacent. En définitive, donner l’alerte aussi souvent que possible. Au niveau collectif, il faut participer aux activités citoyennes sous toutes les formes possibles, non pas en jérémiades, mais en actions collectives. Il faut interroger les responsables politiques en leur demandant de se fixer un horizon de développement soutenable qui dépasse la seule solution des problèmes du moment.
Le défi du nouveau millénaire, c’est celui de la réconciliation de l’homme avec sa planète, la Terre.
André Lefeuvre
de l’Association Hydraulique sans Frontières
avec l’apport d’Ahmed Aïdou
enseignant chercheur à l’Université de Rennes
Tous deux intervenants
aux Journées d’été 2011 de Parvis.
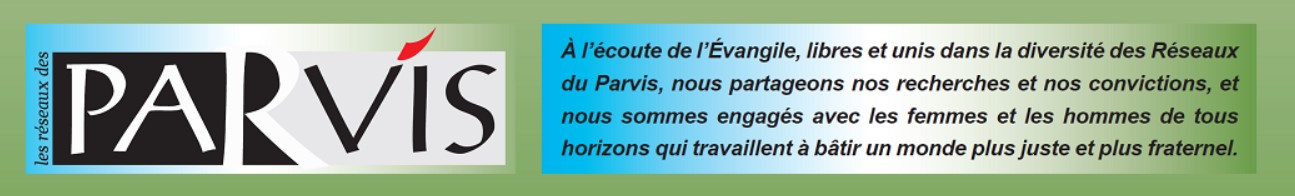

Laisser un commentaire