Une Théologie de la libération pour l’Europe…
Gui LAURAIRE
UNE THEOLOGIE DE LA LIBERATION POUR L’EUROPE ?
Conférence donnée pour Chrétiens et libres en Morbihan
Palais des Arts de Vannes, 22 juin 2012
Tel est le titre proposé pour cette rencontre. Le point d’interrogation est important. Il faut savoir de quoi l’on parle quand on dit : théologie de la libération, avant de pouvoir répondre par oui ou par non à la question posée. Et, tout de suite :
– s’il s’agit de transposer en Europe, en France, la théologie de l’Amérique Latine, je
répondrais volontiers non, car il s’agit précisément d’une théologie contextuelle ;
– s’il s’agit d’élaborer une théologie européenne, française, qui se situe dans la ligne de la
théologie de la libération latino-américaine, alors je dirai oui. Mais il faut s’en expliquer.
En fait, la naissance de la théologie de la libération est assez complexe. Un article de la revue Etudes (septembre 1984) aborde le sujet sous le titre : Les deux théologies de la libération en Amérique Latine. L’auteur, Juan Luis Segundo, s.j., est lui-même impliqué dans le mouvement évolutif qu’il évoque. Il rappelle que c’est autour des années 1960 que la foi chrétienne a commencé à se penser dans un contexte nouveau, et cela au sein des universités. Celles-ci, régies alors par le mouvement étudiant, disposaient d’une grande liberté et constituaient même une sorte de pouvoir parallèle… situation qui, bien sûr, n’allait pas durer avec l’avènement des dictatures. C’est donc là que naît une nouvelle manière de saisir la foi chrétienne.
A partir de la notion de fonction sociale des idéologies, les universitaires se rendent compte que la culture fonctionne au bénéfice des classes dirigeantes. Les étudiants et professeurs chrétiens vont inclure la théologie pratiquée alors dans les mécanismes idéologiques structurant cette culture. Leur souci va être d’oeuvrer pour démasquer les éléments non-chrétiens, voire anti-chrétiens, dans une société soi-disant chrétienne. Par exemple le Dieu qu’on a enseigné au peuple, et qui n’a pas grand chose à voir avec le Dieu de Jésus Christ. Il faudra y revenir tout à l’heure. Cet enseignement a donné à ce peuple un grand attachement à la croix. C’est admirable, certes, … mais ça s’arrête là ! Avec J.L. Segundo, je cite Leonardo Boff parlant des chrétiens de base : « Peut-être cela tient-il à ce que leur vie n’est faite que de souffrance et de croix, la croix que la société a réussi à leur faire porter sur les épaules…. Un Jésus qui se borne à souffrir ne libère pas : il engendre le culte de la souffrance et le fatalisme. Il importe de remettre la croix à sa vraie place dans l’esprit des gens du peuple. »
Il va s’agir alors de s’engager à mettre sa réflexion au service des pauvres et opprimés, et d’analyser ce qui, dans leur praxis, par le biais de la théologie, est associé aux mécanismes oppresseurs de la culture. Mais il faut aussi trouver une théologie autre, qui puisse transformer cette praxis dans un sens plus libérateur, évitant passivité et fatalisme. On est donc dans la recherche d’un orthopraxie, sans négliger en aucune manière l’orthodoxie. Avec l’espoir que par une pastorale adaptée, cela atteindra les diverses classes sociales.
En fait, ce sont les milieux bourgeois, fournisseurs des universités, qui ont accueilli cette démarche, eux qui découvraient en même temps qu’ils appartenaient au camp des oppresseurs, à ceux à qui profitait l’idéologie qu’il s’agissait maintenant de débusquer et de combattre. Certains entrèrent délibérément dans cet engagement de libération des pauvres, aux dépens de leurs propres intérêts.
Mais il se trouve que, au cours de la décennie 1970-1980, naissent des mouvements populaires. On va alors sortir de l’idée qu’il faut parler et agir pour le peuple – qui d’ailleurs a du mal à comprendre ces intellectuels – et qui, lui, dessine un nouveau courant historique. Les théologiens entrent dans une phase nouvelle : il faut serenoncer, se mêler à ces mouvements populaires. Il faut se mettre à l’école des pauvres pour comprendre comment les pauvres vivent leur foi. Leonardo Boff, d’abord impliqué dans le premier type de théologie ‘de la libération, donne le principe méthodologique du second en ces termes : « Dans une Eglise qui a opté pour le peuple, pour les pauvres et leur libération, l’étude principale de la théologie se fait au contact de la base. Qui est-ce qui évangélise le théologien ? Les fidèles qui témoignent de leur foi, de leur capacité à mettre Dieu dans toutes leurs luttes, de leur résistance à l’oppression dont ils ont habituellement à souffrir » Les théologiens vont s’intégrer aux mouvements populaires et comprendre que la religion populaire, qu’ils avaient tendance à suspecter, est fort respectable quand on voit en elle un des éléments de la résistance à une culture et une religion importées et oppressives. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas garder à son propos un certain sens critique. Mais on ne peut l’exercer positivement que de l’intérieur.
Si l’on compare la religion populaire à la religion officielle prise comme norme, alors oui la religion populaire peut être vue comme suspecte et déviante. Mais si on compare les deux en regardant les fruits qu’elles portent, les qualités humaines et spirituelles qu’elles produisent, alors je ne suis pas sûr que le résultat soit le même !
Il faut rappeler qu’entre ces deux formes de la théologie de la libération, il y a eu le concile Vatican II (octobre 1962 – décembre 1965) et son actualisation pour l’Amérique Latine à l’assemblée de Medellin (octobre 1968). Et Medellin peut être considéré comme la naissance officielle de cette deuxième théologie de la libération à laquelle un livre de Gustavo Gutierrez, paru en 1971, donnera un écho international. C’est celle qui va plus directement nous intéresser ici ; sans oublier qu’elle a essaimé dans le monde entier, et qu’il existe des théologies de la libération noire nord-américaine, féministe, africaines, asiatiques…
Il s’agit pour nous d’accueillir l’inspiration sans être des imitateurs. C’est pourquoi ce sont surtout la manière d’être et de faire, et la méthodologie, qui nous importent. Il faut se souvenir que, au début, cette théologie n’a pas suscité un grand intérêt en Europe, en dehors de quelques théologiens comme Marie-Dominique Chenu, Christian Duquoc, et certains de ceux qui travaillaient en lien avec l’action catholique spécialisée. En revanche, elle a très vite été suspectée par le Vatican puis contestée et attaquée. Or, ce ne sont pas des erreurs doctrinales qui ont provoqué la colère de Rome, mais bien plutôt la méthodologie. S’engager sur ce terrain, c’est donc prendre un certain risque.
Toutefois, penser ce type de théologie dans un contexte français, et plus largement européen, me semble bien opportun. Ceci dit, si je tiens à la démarche, je ne tiens pas absolument à l’appellation. Au premier congrès international de Chimbote (Pérou), en septembre 1986, Mgr Julio Xavier Labayen, des Philippines, disait : (Il faut) «chercher une théologie de la lutte, qui parte des masses populaires, qui ébauche une stratégie pour qu’elles prennent leur place. » Et encore : « Maintenant, nous en sommes plutôt à penser à la théologie de la lutte, c’est à dire donner du relief à la lutte du peuple, dans laquelle le peuple ait le droit de prendre sa place aussi bien dans la société que dans l’Eglise. Parce que, dans la théologie de la libération, la stratégie pour le peuple n’est pas claire, elle n’est pas claire quant au rôle du peuple, de la masse. »
Partons d’un mot d’actualité : la crise.
On en parle beaucoup, surtout depuis qu’elle a frappé de plein fouet le système financier. Mais elle est beaucoup plus ancienne, et profonde. On sait que toute crise est à la fois une épreuve à vivre et une chance offerte. Il s’agit donc de discernement à opérer et de décision à prendre. C’est une heure de vérité, un moment décisif.
Cette crise, cet état de crise dans lequel nous vivons, Marx l’avait annoncée, et nous y sommes. Moment difficile où, devant l’incertitude, la peur de l’avenir, on risque de se replier et de se fixer sur le passé. Alors qu’il est urgent de saisir le présent dans l’espérance. Dans l’interview qu’il a accordée à Télérama le 7 mars 2012, Giorgio Agamben dit ceci « Dans le vocabulaire de la médecine antique, la crise désigne l’instant décisif de la maladie. Mais aujourd’hui, la crise n’est plus provisoire : c’est la marche même du capitalisme, son moteur interne. Elle est toujours en cours, car, pareille en cela aux autres dispositifs d’exception, elle permet au pouvoir d’imposer des mesures qu’il ne serait pas possible de faire accepter en temps normal. »
Mais avant même d’être financière, économique, la crise actuelle est une grande crise sociale et culturelle. Au fond, la civilisation occidentale et prétendue chrétienne n’a plus rien à dire au monde présent. Et cela concerne aussi nos Eglises. Les pays occidentaux ont utilisé leur technique, leurs richesses, pour dominer le monde. Mais ces puissants sont fragiles. ils se sont auto – détruits en deux guerres mondiales… et ils en sont sortis plus forts et plus corrompus.
En même temps se développe une force chaque jour plus grande et plus universelle, celle des pauvres : les migrants, les déplacés … les femmes ; toutes ces personnes dépréciées, rejetées, marginalisées. Ces pauvres ne sont pas nécessairement conscients de leur force ; ils ne sont pas toujours organisés, et leur colère ne s’exprime qu’épisodiquement. Mais il y a là un potentiel énorme… et qui fait peur. D’où les réactions policières violentes. Ici ou là, il y a des signes précurseurs de nouveauté, d’un monde autre : quel nom lui donner ?
Pour les chrétiens, avant Mai 68, Vatican II, et Medellin pour l’Amérique Latine, ont été comme des cris prophétiques au moment de la crise. Ils peuvent nous aider à nous situer. Ce n’est pas pour rien que le pouvoir de la curie romaine a aussitôt mis la marche arrière. Car le débat est sur Dieu, un Dieu que l’on s’est efforcé de domestiquer, que l’on a retiré des pauvres et de l’histoire. Nous en avions fait une idole, une triste idole, même quand on lui donnait le nom de Jésus, hélas ! Dieu à l’image des puissants. Celui auquel on a envie de crier avec Job (7, 19–20) : « Quand cesseras-tu de m’épier ? …espion de l’homme. » Or Vatican II avait remis Dieu dans l’histoire et reconnu la liberté de conscience. Il faut donc repenser Dieu, il faut faire théologie. Et cela d’autant plus que l’affrontement aujourd’hui est sérieux et particulièrement rude. Je laisse à nouveau la parole à G. Agamben : « Les dernières recherches que j’ai entreprises m’ont montré que nos sociétés modernes, qui se prétendent laïques, sont au contraire gouvernées par des concepts théologiques sécularisés qui agissent avec d’autant plus de puissance qu’ils ne sont pas conscients. Nous n’arriverons jamais à saisir ce qui se passe aujourd’hui sans comprendre que le capitalisme est en réalité une religion. Et, comme le disait Walter Benjamin, il s’agit de la plus féroce des religions car elle ne reconnaît pas d’expiation… » Et plus loin il ajoute : « En gouvernant le crédit, la Banque, qui a pris la place de l’Eglise et des prêtres, manipule la foi et la confiance des hommes. Si la politique est aujourd’hui en retrait, c’est que le pouvoir financier, en se substituant à la religion, a séquestré toute la foi et toutes les espérances. »
Voilà qui nous ramène au coeur de la Bible : la lutte contre l’idole. Car cette pseudo religion qu’est le capitalisme n’est en fait qu’une idolâtrie au service de l’idole, qu’on l’appelle Profit, Marché, Argent, ou qu’on lui donne n’importe quel autre nom. Or dans la Bible, le débat de fond n’est pas entre foi et incroyance, mais entre foi et idolâtrie, entre foi en un Dieu ami des hommes avec qui il fait Alliance, et asservissement à l’idole qui écrase l’homme et exige de lui des sacrifices humains. On en est bien là. J. Chonchol attirait déjà notre attention, en 1981 sur ce qui est de plus en plus évident : pour continuer à se développer, le capitalisme, dans sa forme de libéralisme sauvage, est porteur de deux fruits : l’exclusion de plus en plus d’humains et le massacre de la nature.
Nous sommes donc sortis de l’illusion qui a longtemps été la nôtre : nous étions dans le camp de la liberté, contre les dictatures communistes et leur menace. Le capitalisme, c’était la liberté. Et c’était pour la défendre, disait-on, qu’on soutenait, ou même qu’on suscitait, les dictatures latino-américaines, africaines, celles des pays arabes, et la pression d’Israël sur ses voisins. Et force est de reconnaître que beaucoup gardent encore cette vision, même si la menace a changé de nature.
Malgré tout, cela est remis en question. On commence à se rendre compte qu’il s’agit en fait de la liberté « des riches, de plus en plus riches, aux dépens des pauvres de plus en plus pauvres. » Qu’en est-il, en effet, de la liberté des pauvres de plus en plus nombreux, menacés de franchir le seuil de la misère, même dans les pays riches, même chez nous ? Parler de liberté à des personnes empêchées de vivre décemment est une insulte.
Il est donc grand temps de se mettre à l’oeuvre, c’est-à-dire d’engager des actions libératrices coordonnées, et de mettre en oeuvre une réflexion théologique capable d’accompagner et d’impulser cette action. Avec la conscience que c’est au coeur de l’action et des engagements qu’elle exige, que cette théologie peut naître et se développer.
Alors, comment s’y prendre, que faire ?
J’ai déjà dit que Vatican II et Medellin ont été des cris prophétiques, cris que, malheureusement, on s’efforce de faire taire depuis Jean Paul II, et même avant dans certains secteurs ecclésiaux. A contre-courant, essayons d’en tirer parti. On se souvient que Jean XXIII visait trois grands objectifs en convoquant le concile :
– Restaurer le dialogue entre l’Eglise et le monde actuel.
– Favoriser l’oecuménisme.
– S’ouvrir aux pauvres.
Les deux premiers objectifs ont sérieusement été traités, pas le troisième. En effet les évêques des pays défavorisés ont peu pris la parole, mais ils ont eu une certaine influence dans des réunions informelles. Et c’est Medellin qui a mis ce troisième objectif au coeur de sa réflexion. Prenons appui sur ces deux évènements d’Eglise.
Il y va d’abord du sens de l’Eglise.
Elle est de l’ordre des signes et des moyens ; le début de la Constitution sur l’Eglise le dit clairement. Elle n’a donc pas sa fin en elle-même. Elle est servante : servante du Règne de Dieu dans le monde ; servante du monde à organiser en vue du Règne de Dieu qui est là, présent, mais qui doit se développer jusqu’à atteindre sa plénitude.
Parmi les passages que Vatican Il nous appelle à franchir, j’en retiens deux :
– d’une conception juridique, mettant l’accent sur l’institution et la hiérarchie, à une conception biblique de l’ordre de la communion dans la foi et l’amour, mettant l’accent sur un peuple fraternel où chacun se sente responsable de l’ensemble.
– d’une insistance sur les structures de pouvoir, avec les abominables oppositions autorité /sujet, enseignant /enseigné … à une mise en valeur du service par un peuple tout entier habité et dynamisé par l’Esprit Saint, et organisé avec des ministères mettant en oeuvre les charismes de chacun.
Il faut donc une Eglise qui fasse signe et qui ait de la signification. Qu’elle soit porteuse de projet, et d’espérance. Une Eglise qui se risque, au lieu de se replier peureusement sur une morale plus bourgeoise qu’évangélique. L’Eglise n’a pas à chercher son propre intérêt si elle veut être l’Eglise de Celui qui s’est dépouillé lui-même et qui s’est donné jusqu’à l’extrême.
Il y va aussi de l’image de Dieu que l’Eglise veut donner.
On a parfois présenté Jésus comme le Dieu qui se sacrifie pour que le Père puisse pardonner les péchés des hommes. C’est alors l’image d’un Dieu de la mort, d’un Dieu avide de sang, jusqu’à celui de son propre Fils. Est-ce là le Dieu de tendresse et de miséricorde ? Vatican II nous a rappelé que Dieu se révèle, et se donne à rencontrer, dans l’histoire, la nôtre aujourd’hui comme celle d’Israël autrefois. Le Dieu de Jésus, il est présent à l’histoire humaine pour la féconder. Il n’est pas possession de l’Eglise, son bien propre. Il nous précède, il est là bien avant nous et il agit par son Esprit. Du coup, évangéliser, ce n’est pas importer un objet étranger, c’est reconnaître et permettre de reconnaître Celui qui est déjà là, et qui est le Dieu de la vie, le Dieu d’amour. Le Dieu qui est Père-Mère de tous et qui espère nous voir vivre comme des frères. Bien sûr, pour rencontrer ce Dieu là, il faut être bien présents, attentivement présents, à l’histoire en train de se faire. Chercher Dieu hors de l’histoire, c’est s’exposer à coup sûr à ne trouver qu’une idole.
Et il y a la place du pauvre
L’option pour le pauvre, le petit, le laissé pour compte, ce n’est pas une mode, ce n’est pas d’abord une option politique, c’est un choix christologique, évangélique. C’est le choix qu’a fait Jésus. Suivre Jésus, c’est faire ce même choix : il a mis au coeur de son Evangile celles et ceux que la société de son temps mettait en marge. Pour l’Evangile, le pauvre est présence de Jésus. Jésus s’est identifié au malade, au prisonnier, à l’exclu, à l’opprimé…Telle a été sa volonté. Or l’Eglise doit vivre la pratique de Jésus pour être vraiment son Corps. Il n’est pas possible de suivre Jésus sans le reconnaître et le servir dans le pauvre.
Mais il y a plus. Le pauvre est signe que le Règne de Dieu n’est pas encore accompli, puisque la fraternité n’est pas vraiment vécue tant que lui en est exclu. Il est donc signe de Dieu qui conteste la société présente, comme infidèle à sa volonté. Il faut encore ajouter que le pauvre, en solidarité avec les autres pauvres et avec ceux qui optent pour partager leur combat, possède une extraordinaire force historique de transformation. N’ayant aucun intérêt à maintenir cette société qui le rejette, il peut mobiliser ses forces pour qu’advienne une société autre. On ne peut vraiment servir la transformation radicale que sera le Règne de Dieu en plénitude, sans se solidariser avec ceux qui, aujourd’hui, portent les chances de transformation. Mais cela suppose prise de conscience et engagement réel, lucide et critique.
Ces apports de Vatican II et Medellin questionnent déjà nos options et engagements. Mais après ces rappels, je voudrais en arriver plus directement à ce que demande, de notre part, la perspective d’une théologie de type libération pour nos pays.
1 – Tirer profit de l’expérience de la première théologie de libération en Amérique latine
Elle est venue d’une prise de conscience à partir de la notion de fonction sociale des Idéologies. Et à mon sens, nous pouvons en recevoir trois leçons :
– La première, c’est que la philosophie, qui a toujours sous-tendu la théologie, ne suffit plus aujourd’hui. Nous disposons d’autres instruments pour analyser le réel, et il n’y a aucune raison de ne pas les utiliser.
– La deuxième est que cette théologie a voulu arracher le peuple à ce qu’elle désignait sous les noms de passivité et de fatalisme. C’était là une vue de l’extérieur, entraînant une action plus ou moins paternaliste, menée en position dominante.
N’en est-il pas ainsi encore dans bien des actions en faveur des pauvres et des pays pauvres ? Heureusement, il y a des organismes, des associations, qui ont dépassé ce point de vue, et qui respectent vraiment les cultures des pauvres. Il y a là un critère de discernement.
– La troisième, c’est que plusieurs de ceux qui ont vécu cette étape, ont pris conscience qu’ils appartenaient eux-mêmes au camp des oppresseurs. Et c’est là pour nous une prise de conscience nécessaire. Même si plusieurs pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, sont victimes du libéralisme sauvage actuel, et si nous le sommes aussi, nous ne le sommes pas de la même manière. Permettez-moi de citer ici un document du 28 février 1977, signé par sept évêques français marqués par le concile… (citation)
Tout en réfléchissant, et en théologisant sur ce dont nous avons à nous libérer, n’avons-nous pas aussi à voir ce que la Bible nous dit sur l’installation après l’exode et après l’exil. Les livres de Samuel et des Rois, et les prophètes, sont riches de
renseignements, recherche de sécurité à tout prix, division sociale et exploitation des pauvres par les riches, culte formaliste coupé de la vie, hypocrisie de la vie religieuse… Bref, ce sont là les moments où l’Alliance est le plus mise à mal. Le prophétisme est un cri qui dénonce et qui appelle à un sursaut, à une désinstallation. Il y a toujours eu des prophètes, il y en a aujourd’hui, mais les puissants ont bien des moyens de couvrir leur voix et, s’il le faut, de les supprimer. Et si l’Eglise n’a plus les moyens de les supprimer, elle sait encore étouffer leur voix.
En travaillant à une théologie de libération, n’oublions pas cette autre face des choses qui caractérise pour une part notre situation. C’est là une démarche complémentaire, et, peut-être préliminaire.
2 – Approfondir notre connaissance des Ecritures.
Pour les croyants chrétiens, la Bible est la référence fondamentale, celle à laquelle il faut toujours revenir. Produite par un peuple qui l’a sans cesse reprise et repensée à travers son histoire, elle est Parole de Dieu lorsqu’elle est lue en peuple, et lorsqu’elle passe en actes. Certes, il y a entre elle et nous une distance culturelle, mais elle n’est pas infranchissable si l’on s’en donne les moyens, et les travaux exégétiques sont précieux pour cela. Mais il y a deux autres obstacles à franchir :
– On s’imagine souvent que lire et comprendre la Bible, c’est une affaire de spécialistes. Faux. Certes, leur travail est utile. Mais les vrais interprètes de la Bible sont ceux qui vivent des situations analogues à celles dont le Livre témoigne. C’est un rapport d’expérience à expérience qui est la plus pertinente des clés de lecture.
– C’est pourquoi – et là est l’autre obstacle, de type institutionnel – la lecture des savants dans leurs bureaux et des prélats de tous ordres, n’a pas cette pertinence.. à moins qu’ils ne soient mêlés de près à ces expériences de vie. Il faut donc contester l’affirmation classique d’après laquelle la seule interprétation autorisée de la Parole de Dieu serait celle de la hiérarchie. Non ! il faut redonner la Bible au peuple, comme il faut lui donner la parole. « Si nous ne la lisons pas, ils nous la liront ! » disaient des chrétiens quechuas… et ils savent de quoi ils parlent.
C’est dans ce va et vient permanent entre les engagements dans l’histoire présente, avec les expériences qu’elles entraînent, et la Parole de Dieu, que se forge une théologie concrète. Théologie qui sera donc toujours contextuelle, jamais achevée, et qui consentira sans regret à être contestable, et à disparaître si un autre contexte advient. Claude Geffré dit fort bien que « la valeur d’une théologie se mesure à sa capacité de disparaître. »
Connaître la Bible nous aide aussi à sortir des fameux dualismes qui encombrent nos théologies et nos catéchismes occidentaux. Ils nous viennent de la philosophie grecque, et n’ont rien à voir avec le monde sémitique. Vie spirituelle / vie profane, spirituel / matériel, naturel / surnaturel (alors que c’est au coeur de l’unique histoire que se joue le permanent affrontement de la grâce et du péché), âme / corps (alors que l’homme est une unité qui peut certes être saisie sous divers aspects, mais qui reste indissociable), ici-bas / au-delà (distinction terrible qui a pu laisser croire qu’on devait subir sans rechigner toutes les épreuves et les souffrances présentes pour obtenir un au-delà d’éternel bonheur)…
3. Travailler à refaire un tissu communautaire.
Dans le monde présent, le tissu social s’est défait. Bien des choses y ont contribué, mais le libéralisme ne se maintient qu’en promouvant l’individualisme. Il ne s’agit pas de la personne, car la personne va de pair avec la communauté, tandis que l’individu va de pair avec la masse, et la masse est manipulable à souhait. Voyez la foule qui acclame Jésus entrant à Jérusalem, et qui réclame sa mort quelques jours après.
Refaire des communautés vivantes, c’est une urgence, ça fait partie du combat à mener. D’abord parce que, aussi important que soit l’engagement personnel, il gagne à 7
rejoindre celui d’autres personnes. Mais surtout parce que c’est une exigence de foi. Jésus a fait communauté ; Paul a fait communauté. Les communautés ecclésiales de base, en Amérique latine, sont le terreau sur lequel germe la théologie de la libération. On y trouve la liberté de parole, le débat permanent et constructif, le soutien dans l’engagement, la fraternité vécue, toutes chose qui font tellement défaut dans la société et dans l’institution Eglise. Des communautés, il en existe. CELEM en est une. Le Parvis met ces communautés et groupes en réseau. On est dans la bonne voie, mais il reste tant à faire.
Il est bon que ces communautés puissent communiquer, témoigner de leur vécu et de leurs recherches, s’enrichir d’apports multiples et différents : l’organisation a son importance, même si elle doit rester légère et toujours réformable. Et il faut se méfier des tentations de prise de pouvoir ! En tout cas, c’est là, au contact de praxis diverses, que se fait la théologie, car c’est là que l’on peut rencontrer le Dieu engagé dans l’histoire, et qu’ensuite seulement on peut en parler. La théologie est un acte second.
4. Elargir notre regard.
L’Europe n’est pas isolée dans le monde, et ce qui s’y vit peut avoir des répercussions un peu partout. De même, ce qui se passe ailleurs peut avoir des répercussions chez nous. Nous sommes donc invités à accueillir ce qui nous vient d’ailleurs et qui peut nous questionner, nous enrichir au plan de la réflexion et de la vie. Travailler à ce que tous les mouvements de libération qui existent un peu partout se mettent en relation, communiquent, se soutiennent. La mise en réseau doit s’élargir au plan international. Nous avons en commun d’être faibles face à un ennemi puissant. Ce peut être notre force, si ce que dit Paul dans la première épître aux Corinthiens est vrai : « C’est dans la faiblesse… »
5. Respecter le chemin que Dieu a choisi en Jésus Christ.
Il s’est fait homme. L’humain est donc assez riche pour nous dire quelque chose de Dieu. L’humain est infiniment respectable puisque Dieu a voulu l’assumer. En même temps, Jésus a témoigné d’une certaine manière d’être humain.
Travailler à rendre ce monde toujours plus humain, afin qu’il soit plus conforme à l’espérance de Dieu telle qu’elle s’est manifestée en Jésus, c’est là une priorité absolue. Il ne peut y avoir de christianisme authentique que sur la base d’un humanisme véritable.
Ici se pose la question des repères. Dans le supermarché des propositions offertes en notre temps, il y a plutôt excès de repères que perte de repères. Pour nous, en tout cas, il y en a au moins deux : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et l’Evangile, et cela nous trace un chemin. C’est pour cela que doivent se mobiliser nos communautés d’Eglise. Paul VI a rappelé que c’était la nature même de l’Eglise d’être missionnaire. C’est dire qu’elle ne trouve pas son sens en elle-même, mais hors d’elle, dans le service du monde en vue du Règne de Dieu. Un Règne qui déborde de toute part toutes nos églises. Alors, ne nous y-enfermons surtout pas. La vraie fraternité commence par la fraternité de combat. S’il s’agit de s’engager dans des combats pour subvertir le système écrasant dans lequel nous vivons aujourd’hui, la vraie fraternité, c’est celle des personnes qui sont partie prenante des mêmes combats, avec les mêmes objectifs et en quête des moyens les plus adaptés. Elle déborde tout clivage social, racial ou religieux. L’enjeu est trop grave et trop important pour ne pas mobiliser toutes les bonnes volontés.
Somos Pueblo, somos Iglesia = Nous sommes Peuple, nous sommes Eglise.
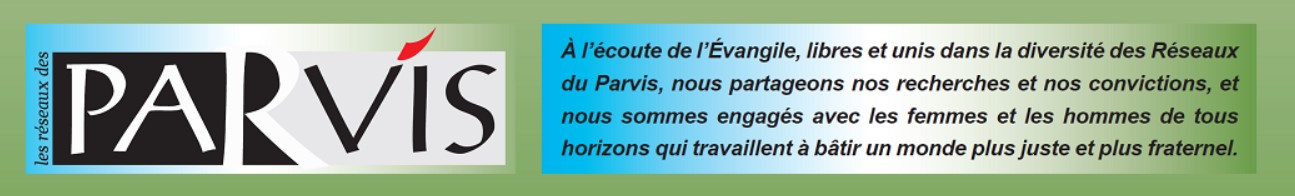
Laisser un commentaire