Marchandisation du monde et subversion chrétienne
L’impasse de l’évolution actuelle
Dans les sociétés développées, la classe supérieure fait étalage d’un train de vie dispendieux – rémunérations élevées, primes diverses (stock options, parachutes dorés, retraites faramineuses), avantages en nature (logements, voitures de fonction, voyages). Tout ce que la société produit de meilleur en termes d’institutions et d’équipements est à son service et lui permet de se reproduire en tant que catégorie dirigeante – les réseaux de relations, l’organisation de la formation (du primaire aux Grandes Ecoles), les structures de santé, les loisirs etc. La classe moyenne profite également de la richesse disponible, mais dans une bien moindre mesure. Livrée à un marché dérégulé qui se soucie plus de la rentabilité à court terme des investissements que de la vie des hommes, cette classe est désormais confrontée à la précarité et tend à s’appauvrir. Quant aux faibles et aux pauvres, ils sont de trop dans ce système et sont repoussés à sa périphérie, survivant vaille que vaille avec des salaires médiocres et avec les diverses prestations sociales qui leur sont allouées pour les aider à se tenir tranquilles (chômage, familles nombreuses). Véritables abcès de fixation de la misère, les banlieues rappellent périodiquement ces dures réalités, mais les explosions urbaines sont vite oubliées.
La situation est beaucoup plus contrastée encore dans les pays du Sud où l’ancienne classe moyenne a été laminée par les politiques d’ajustement structurel entre autres (Fonds monétaire international et Banque mondiale). Ces pays comptent désormais, grâce à ce qu’on appelle abusivement le » développement « , des bourgeoisies locales prospères qui vivent des affaires et de la politique, en relation étroite avec les milieux occidentaux qui les ont fabriquées et qui les soutiennent au bénéfice des intérêts dominants. Les nouveaux riches se regroupent dans des quartiers plaisants, à l’abri des pauvres et dûment gardés (insécurité oblige), à proximité de grands commerces bien achalandés, avec d’immenses antennes paraboliques sur les toits des villas pour vivre au diapason de l’Occident. Leurs enfants sont scolarisés dans les meilleures écoles privées, et l’élite poursuit ses études à l’étranger. Leurs malades sont soignés dans des cliniques pareillement privées, sur place ou dans les pays du Nord.
A l’opposé des beaux quartiers, les bidonvilles des grandes mégapoles du Sud sont en expansion constante et connaissent une misère matérielle et morale sans rapport avec la pauvreté qui était habituelle dans ces sociétés – et qui y était traditionnellement assumée, voire valorisée au nom de la solidarité. Ces villes grouillent de gens qui survivent d’une économie souterraine de misère – exploitation des ordures, prostitution (aggravée par le tourisme), drogue, trafics divers et banditisme. Ils s’entassent dans des ghettos livrés à leur sort, le long d’égouts à ciel ouvert, souvent sans eau courante ni électricité depuis que les services publics ont été privatisés pour desservir les quartiers solvables, sans écoles et sans postes de santé convenables. La menace des révoltes de la faim y est constante.
Quant aux populations rurales que l’on pourrait croire épargnées, elles se désagrègent et se paupérisent au contact de l’économie de marché et des modes de vie urbains qui se répandent partout. L’agriculture de subsistance s’effondre, bousculée par l’introduction de techniques nouvelles et coûteuses inaccessibles aux cultivateurs démunis (intrants, mécanisation), concurrencée par des investissements extérieurs (plantations industrielles, périmètres irrigués) et par des importations à bas prix de produits subventionnés dans les pays avancés (céréales, poulets), voire ruinée par les fluctuations des cours mondiaux des productions de rente (café, cacao, arachide, coton). Expulsés du système de production traditionnel, les ruraux pauvres refluent vers les villes où ils ne trouvent pas d’emplois, ou seulement des emplois occasionnels mal rémunérés. Une partie de ces déracinés, attirés par les images alléchantes que déverses nos satellites et notre publicité, migreront vers nos eldorados – dans les conditions et pour le sort que nous savons.
Personne ne sait où mènera cette fuite en avant qui emporte le monde hors de toute régulation politique ou éthique. Grosso modo, quatre sortes de morts nous guettent : la perte des valeurs constitutives de l’homme sous l’effet de la mutation induite par la marchandisation, l’étouffement par la pollution que produit le productivisme (réchauffement climatique), un accident d’ordre technologique (par exemple nucléaire), ou une initiative criminelle (du genre terrorisme chimique, bactériologique ou nucléaire). L’humanité entière se trouve au pied du mur, acculée à prendre conscience du désastre qui menace, à se rebeller contre l’inacceptable fatalité. Il est vrai que les hommes ont déjà surmonté maintes crises au cours de leur longue histoire, mais les dangers actuels sont sans précédent en raison du saut technologique qui a entraîné une contraction de l’espace géologique, une accélération de l’histoire et l’accumulation d’un gigantesque potentiel de destruction. Pour ne pas périr, il faut créer du neuf. L’altermondialisme – qui a ses racines dans la tradition judéo-chrétienne – permet d’espérer un nouvel avenir pour l’homme, mais rien n’est acquis et il ne faut pas se cacher que de rudes combats seront nécessaires. C’est David contre Goliath.
Pertinence de la subversion évangélique
La société de consommation somme ses membres de consommer – c’est la première condition de sa survie. Elle nous somme de festoyer en ignorant que le marché où règne l’abondance recouvre une immense cave remplie d’affamés, de prisonniers, de suppliciés et de cadavres. Ce souterrain est si sordide qu’il est inconvenant d’en parler – les esprits chagrins devraient savoir, dit-on, « qu’on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, que ça ira mieux demain, et que – de toute façon – on ne peut rien contre la fatalité « . Mais pour l’évangile, tous les hommes, dans quelque civilisation ou religion que ce soit jusqu’au bout de la terre, sont pareillement aimés par Dieu, tout de suite et sans condition préalable.
Il n’existe ni sous-hommes ni fatalité. Le Christ est présent en tout ce qui est humain, et plus particulièrement dans l’humanité rejetée : il souffre et agonise partout où l’homme soufre et agonise. C’est là où gît l’humanité humiliée et piétinée que s’offre le visage de Dieu qui a gravi le Golgotha.
Contre notre raison er contre toute raison, le Dieu des chrétiens s’est positionné du côté des victimes. Telle est sa spécificité : à la différence de tous les dieux antérieurs comme de tous qui ont surgi depuis, le Dieu crucifié des chrétiens – » scandale pour les juifs et folie pour les païens » (cela se comprend) – est d’abord solidaire des hommes qui subissent la violence. Quelles que soient les » bonnes raisons » avancées par les justiciers et les bourreaux, qui ont toujours d’excellentes raisons et aiment à se réclamer de la volonté divine, ce Dieu ne se tient pas du côté de l’ordre social qui pratique la brutalité. Il en ressort, inéluctablement, que les haines et les violences engendrées par l’iniquité sont d’abord imputables à ceux qui entretiennent l’iniquité à leur profit, et non pas d’abord à ceux qui la subissent. Ce jugement oblige à accepter les pauvres tels qu’ils sont, sans prendre en considération les mérites ou les torts que la société leur attribue, à se faire proche d’eux, à partager leurs souffrances et à se mobiliser pour les en délivrer autant que possible.
Ce ne sont donc pas seulement les » bons pauvres » qui doivent nous émouvoir et nous préoccuper, ceux qui sont tels que nous les aimons, reconnaissants de nos bienfaits et méritants. Mais ce sont aussi et surtout les autres, ceux qui sont devenus nos adversaires, voire nos ennemis : ses fondements et ses agissements sont injustes, avant de condamner et de combattre ceux qui s’en prennent à cet ordre qui les méprise et les écrase.
Conclusion
» Heureux les pauvres selon l’esprit, car le Royaume des cieux est à eux « . Cette béatitude demeure plus que jamais pertinente. Mais la pauvreté sans la vertu de pauvreté n’est que malheur, tandis que la vertu de pauvreté sans le combat contre l’injustice subie par les pauvres n’est qu’illusion. L’Evangile n’a pas changé, mais pour le vivre aujourd’hui, le christianisme doit opérer une véritable révolution copernicienne. Nous ne pouvons plus croire, avec les Eglises, que l’univers tourne autour de notre héritage religieux, de nos dogmes et de nos rites comme s’ils incarnaient l’unique et éternelle vérité, qu’il tourne autour de notre civilisation, de nos droits et de nos intérêts. L’Evangile invite à inverser ces perspectives : ce n’est pas notre religion ou notre ordre social qu’il faut sauver en bétonnant les positions établies, c’est l’homme et le Dieu qui s’est livré à l’humanité qu’il faut accompagner sur nos chemins incertains pour les sauver en ce monde. Pâques ne pouvant pas être célébré avant le Vendredi saint…, il faut nous engager à veiller et à lutter contre le mal – aux risques et périls que cela comporte – en vue de changer le monde et de changer l’Eglise si c’est possible. Mais pour ceux qui acceptent l’épreuve et la mort du Vendredi saint, l’aube pascale éclaire dès à présent tous les tombeaux.
JEAN-MARIE KOHLER.
Extraits d’un texte publié par Jonas Alsace
dans sa revue Vagues d’espérance
Jean-Marie Kohler animera un atelier organisé par Jonas Alsace
et NSAE sur le thème » La révolution évangélique « .
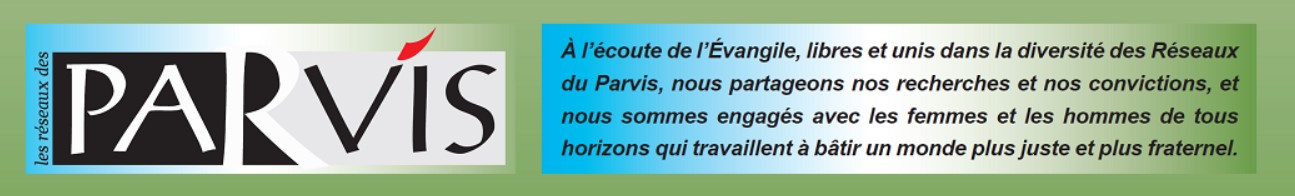
Laisser un commentaire