Le pape François contre le Vatican ?
– La bataille pour refonder l’Eglise
Il est naturel de juger un homme par la voiture qu’il conduit, ou dans laquelle il est conduit, surtout quand l’homme se trouve être le pape. Dans la soirée du 13 mars 2013, peu de temps après que le collège des cardinaux ait élu le deux cent soixante-cinquième successeur de saint Pierre, chef de 1,2 milliard de catholiques dans le monde, Jorge Mario Bergoglio a surpris les autorités de l’Eglise et la presse internationale en refusant la limousine prévue pour le pape et en retournant à son hôtel en bus. Depuis, il a troqué la Mercedes qui transportait son prédécesseur contre une marque et un modèle beaucoup moins fantaisie. La papamobile du pape François est une Ford Focus.
Les gestes ont continué. Le pape, qui cherché son nom papal auprès de Saint François d’Assise, apôtre des opprimés, a exhorté ses admirateurs dans son Argentine natale à donner de l’argent aux pauvres au lieu de le dépenser pour un voyage destiné à venir présenter leurs hommages à Rome. Il a choisi de résider dans la modeste maison d’hôtes du Vatican plutôt qu’au Palais apostolique comparativement plus somptueux et indiqué clairement qu’il préfère porter ses bagages. Le Jeudi Saint, le pape François a lavé les pieds de deux femmes en détention des mineures, dont l’une était musulmane, rompant avec la tradition qui limite le rituel aux hommes et surtout aux prêtres de l’entourage du Vatican.
Ces expressions de modestie et l’humilité ont été un choc pour de nombreux observateurs. D’octobre 1978, lorsque Karol Józef Wojtyła est devenu le pape Jean-Paul II, jusqu’en février dernier, lorsque son successeur, le pape Benoît XVI, a renoncé au trône, le monde était devenu habitué à un style de direction du Vatican très différent. Les deux derniers papes semblaient se réjouir de s’élever au-dessus des laïcs, avec des manifestations théâtrales de pompe pontificale. Tous les deux ont permis au cléricalisme de s’épanouir, parfois (comme dans le cas des abus sexuels d’enfants par des prêtres et leur couverture par des fonctionnaires de rang supérieur) avec des conséquences horribles. Tous deux semblaient prendre plaisir à reprocher ses péchés (essentiellement sexuels) au monde occidental .
Les catholiques progressistes, démoralisés et marginalisés dans leur Eglise pour la majeure partie des 34 dernières années, ont répondu avec enthousiasme au changement de ton de François. Et leur enthousiasme s’est intensifiée après la conférence de presse inopinée lors du vol de retour des festivités de la Journée mondiale de la Jeunesse à Rio de Janeiro, fin juillet. Répondant à une question au sujet de prêtres homosexuels, François a parlé de l’homosexualité dans un langage beaucoup moins de condamnation («Qui suis-je pour juger? ») que Jean-Paul ou Benoît auraient choisi de le faire.
Dans un billet de blog intitulé « Ce pape extraordinaire », Andrew Sullivan, un catholique gay au franc-parler, a exprimé les sentiments de beaucoup de membres de l’Église partageant les mêmes idées : « Ce qui est frappant pour moi, ce n’est pas ce qu’il a dit, mais comment il l’a dit : la douceur, l’humour, la transparence. Je me retrouve avec des larmes aux yeux quand je le regarde. J’ai vécu longtemps à attendre un pape qui parle comme ça », a écrit Sullivan. « Tout ce qu’il dit et fait est une décision implicite de rejet évident de ce qui est venu avant. » Cette conviction – que le pape est en train d’opérer une rupture radicale avec le passé – est rapidement devenue la vision conventionnelle. Même un analyste habituellement aussi sobre et sensible que John L. Allen Jr. du National Catholic Reporter est allé jusqu’à conclure que rien moins qu’un « révolution » est en cours au Vatican.
Ce n’est pas le cas. Le regain d’attention de François pour les pauvres est certainement bienvenu et précieux, et il y a des zones circonscrites dans lesquelles le Pape peut réaliser de véritables réformes. Mais quand les catholiques progressistes pointent le changement, ils veulent dire surtout qu’ils veulent voir l’Eglise mise en conformité avec l’éthique égalitaire du libéralisme moderne, y compris les droits des homosexuels, la liberté sexuelle, l’égalité des sexes. Et cela ne va tout simplement pas se produire. Espérer ou attendre le contraire, c’est mal interpréter ce pape, mal interpréter l’héritage de ses prédécesseurs, et méconnaître la structure ossifiée de l’Eglise elle-même.
Tout pape qui voudrait changer radicalement l’Eglise catholique aurait à le faire à travers les processus et procédures de l’institution et c’est une institution apparemment conçue pour contrecarrer cette ambition. Considérez comme un contre-exemple le système politique américain. Les commentateurs notent souvent, à juste titre, la façon dont il est conçu pour contrecarrer la volonté des soi-disant réformateurs, avec de nombreux points de veto ; les représentants de différentes branches tirant leur soutien de différentes circonscriptions, souvent en conflits, etc. Pourtant, il est également vrai que quand un président américain entre en fonction, il a un pouvoir considérable pour façonner presque instantanément ses nombreux ministères et leurs priorités. Oui, chaque bureaucratie est composée de fonctionnaires de carrière qui demeurent d’une administration à l’autre. Mais le chef de la direction obtient de nommer les responsables, en les choisissant librement dans son parti et parmi les personnes alliées dans le secteur privé.
Un nouveau pape, en revanche, a relativement peu de liberté pour refaire le casting idéologique de la Curie romaine, tel que l’on connaît l’appareil administratif du Vatican. Bien que les cardinaux et archevêques qui dirigent les différentes congrégations, tribunaux, conseils, commissions, académies et autres bureaucraties qui composent la Curie démissionnent habituellement après la mort d’un pontife, les personnes nouvellement nommées pour les remplacer doivent être choisies uniquement dans les rangs existants des cardinaux et archevêques, qui tous auront été promus à leurs positions par ses prédécesseurs. En arrivant à la suite de 34 années du solide conservatisme théologique et doctrinal de Jean-Paul II et Benoît XVI, François a hérité d’une église dotée au plus haut niveau d’hommes qui s’opposent à tout changement. Imaginez un président démocrate nouvellement élu qui tenterait de faire avancer le pays dans une direction plus progressiste tout en étant obligé de choisir son cabinet et ses conseillers entièrement dans les rangs du Parti républicain, et vous commencez à avoir une idée des contraintes dans lesquelles il opère.
Mais supposons que François décide de poursuivre cependant un programme progressiste, et qu’il commence à tenter de lever l’interdiction de prêtres mariés. Dans un entretien qu’il a accordé en 2012, celui qui était alors le cardinal Bergoglio a indiqué qu’il était prêt à envisager de réformer le célibat obligatoire. « Il peut changer », a-t-il dit, car c’est une « question de discipline, pas de foi. » Ce qu’il voulait dire, c’est que la règle n’est ni un dogme ni une doctrine de l’Eglise. Et cependant il a clairement indiqué qu’il était en faveur du maintien de la pratique actuelle de l’Église « pour le moment » ; il l’a fait dans une déclaration utilisant tout le temps le langage conditionnel, tout en reconnaissant que le célibat a de nombreux « avantages et inconvénients » et en qualifiant d’ « hypothétique » un processus futur de réforme.
Au-delà de ces remarques, il est possible d’esquisser comment François pourrait chercher à conduire l’Église vers l’autorisation du mariage des prêtres. La première étape serait pour lui de mettre en place une commission pontificale pour étudier la règle du célibat, son impact sur la vie et le travail du clergé, et surtout son rôle dans l’effondrement alarmant des ordinations sacerdotales dans le monde occidental. (Aux États-Unis, la population de prêtres a diminué, passant de 59.000 en 1975 à environ 39.000 l’année dernière, dont beaucoup approchant ou ayant dépassé l’âge de la retraite.) On peut supposer que la Commission tenterait également de s’appuyer sur le fait que l’Eglise a permis au membres du clergé anglican mariés de devenir prêtres quand ils se convertirent au catholicisme, une pratique qui a déjà produit de nombreux prêtres mariés dans les pays à travers le monde. Plus important encore, il pourrait identifier des bases historiques de la réforme. Le célibat des prêtres n’a pas été uniformément appliquée dans l’Église occidentale pendant plus de mille ans après le ministère de Jésus-Christ, et il n’a jamais pris racine dans l’orthodoxie orientale.
Ces justifications, ou quelque chose de très proche d’elles, devraient émaner de la commission et ensuite François lui-même devrait indiquer clairement et avec autorité que lui et les dicastères compétents sont en faveur du changement. (Ce que ni le pape, ni la Commission ne pourraient dire en public, c’est que permettre le mariage des prêtres ferait également du sacerdoce un refuge moins attrayant pour des hommes sexuellement perturbés qui se retrouvent à molester des enfants.) Le pape aurait aussi probablement essayé de coopter un poignée d’éminents conservateurs pragmatiques, comme Timothy Dolan, archevêque de New York, John Onaiyekan, archevêque d’Abuja au Nigeria, ou Odilo Scherer, archevêque de São Paulo et les amener à coopérer.
Et pourtant, de nombreux représentants de l’Eglise refuseraient d’accepter des prêtres mariés. Pas tellement parce que les catholiques conservateurs sont particulièrement attachés au célibat ecclésiastique, mais en raison de leur suspicion généralisée envers tout changement. L’un des héritages du Concile Vatican II est un large consensus au sein de la hiérarchie de l’Eglise sur le fait que la rupture avec la tradition proposée ne peut être reçue que si elle peut être formulée comme approfondissant la continuité. D’abord formulé par John Henry Newman, en 1845, le concept est connu comme « le développement de la doctrine », et il signifie que tout changement doit réaffirmer l’immuabilité sous-jacente de l’Eglise. Les conservateurs se le sont appropriés au milieu des bouleversements de la fin des années 1960 et au début des années 1970, et il a servi de frein remarquablement efficace à l’innovation ou la réforme.
Mais même sur des questions qui ne sont pas du niveau de la doctrine, comme autoriser les prêtres à se marier, il y a chez beaucoup de membres de la hiérarchie la présomption vague qu’il faut résister au changement en tant que tel. Vatican II a convaincu ces conservateurs que les réformes doctrinalement justifiables inspirent des appels à d’autres toujours plus audacieuses. Ces mêmes conservateurs considèrent les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI comme ayant imposé de nouveau l’autorité dont l’importance est cruciale dans une Église qui a été dangereusement proche de l’effondrement dans le chaos de la fin des années 60 et des années 70. Ils sont réticents à appuyer un changement assez audacieux pour risquer un retour à ces temps tumultueux.
Si l’autorisation du mariage des prêtres est peu probable, d’autres réformes progressistes sont pratiquement inconcevables. Pour beaucoup de fidèles dans le monde occidental, supprimer l’interdiction de l’utilisation du contrôle artificiel des naissances chez les couples mariés semble de simple bon sens ; si peu de catholiques américains dans la vingtaine et la trentaine suivent la règle que leur pourcentage tombe dans la marge d’erreur des sondages. Mais des laïcs ailleurs (notamment en Afrique et dans la propre Amérique latine du Pape, où, contrairement aux Etats-Unis et en Europe, l’Eglise est en croissance) sont plus en accord avec l’enseignement de l’Église sur cette question, ce qui renforce les conservateurs. Qui plus est, de l’avis des conservateurs, dont beaucoup ont été influencés par la mythologique « théologie du corps » de Jean-Paul II – tout enseignement sexuel de l’Eglise est aussi essentiel que tous les autres ; si on tire sur un fil, toute la tapisserie se défait. (Cela englobe bien l’enseignement sur les actes homosexuels, que le Catéchisme de l’Église catholique définit notoirement comme « intrinsèquement désordonnés » et « contraire à la loi naturelle. ») Enfin, il y a l’accueil, encore plus improbable des femmes à la prêtrise, parce qu’il remet en cause directement la doctrine ancestrale qui postule que les pouvoirs de l’ordination sont légués à l’Église par Dieu lui-même.
Pour le pape tenter de surmonter ces obstacles, serait risquer de déclencher une scission de la base sur deux fronts, celui des conservateurs opposés aux libéraux au sein de l’Occident et celui des pays du Sud, en général plus conservateurs, qui s’opposent au Nord jugé plus progressiste. Ce sont précisément ces fissures qui se sont ouvertes dans l’Église anglicane au cours des dernières années, quand elle s’est confrontée à un ensemble identique de questions liées à la guerre des cultures. Les catholiques progressistes peuvent argumenter pour déterminer si un tel schisme se révélerait finalement être une bonne ou une mauvaise chose pour leur institution. Mais personne ne doit s’attendre à ce qu’un pape le provoque délibérément.
Bien sûr, tout ce qui précède suppose que François veuille être l’agent affirmé d’un tel changement. La réalité est bien plus sombre que ses supporteurs progressistes semblent le croire. Le fait est que le Vatican n’a pas d’équivalent au « Washington outsider » (note de la traductrice : un candidat à la Maison Blanche hors des partis traditionnels). Pour parcourir tout le chemin vers le sommet de la hiérarchie de l’Eglise, surtout dans une époque dominée par des papes aussi stricts que Jean-Paul et Benoît, un prêtre doit présenter plus qu’une tendance mineure au conformisme.
Et en effet, c’est précisément ce que montre la biographie de Bergoglio. Quand il a été choisi comme pape, les critiques ont mis le doigt sur sa compromission présumée avec la junte militaire en Argentine au cours de la « sale guerre » qui s’étendit de 1976 à 1983. Mais l’accusation la plus grave contre lui – qu’il a dénoncé deux prêtres aux tortionnaires de la Marine – n’a jamais été prouvée. Ce qui est clair, c’est qu’il a refusé de se prononcer publiquement contre le régime, alors même qu’il aurait travaillé dans les coulisses pour aider les gens à fuir la dictature. Des critiques comme le prix Nobel de la Paix Adolfo Pérez- Esquivel ont suggéré que, au cours d’une période sombre de l’histoire du pays, d’autres prêtres, moins célèbres, ont fait beaucoup plus pour défendre les droits de l’homme.
Le portrait qui se dégage est celui d’un homme dont le mélange de vertus et de vices ressemble un peu à celui du pape Pie XII, qui a discrètement sauvé des milliers de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a officiellement déclaré le Vatican neutre dans la bataille contre les crimes des nazis. Dans les moments critiques, tous les deux ont été des négociateurs plus que des leaders moraux, essayant d’aider les victimes de la tyrannie quand ils ont senti qu’ils pouvaient le faire en toute impunité, tout en continuant également à conduire les affaires avec les autorités en refusant de risquer leur bien-être personnel et celui de leur institutions en procédant à des actes d’insurrection plus directs.
Quand Bergoglio abordé la politique de l’Eglise sur les questions sexuelles et de genre, ses positions n’ont pas contesté l’orthodoxie catholique et dans certains cas il l’a fermement défendue. En 2007, après que le gouvernement argentin ait accordé une dérogation pour permettre à une femme handicapée qui avait été violée de subir un avortement, il a dénoncé la décision en termes enflammés, affirmant que, « En Argentine, nous avons la peine de mort : un enfant conçu par le viol d’une femme souffrant de troubles mentaux ou attardée peut être condamné à mort. » En 2010, il a décrit un projet de loi visant à légaliser le mariage homosexuel dans le pays comme « le rejet total de la loi de Dieu gravée dans nos cœurs » et a prié pour que « Saint- Joseph, Marie et l’enfant nous soutiennent, nous défendent et nous accompagnent dans cette guerre de Dieu. » Puis, devant le tollé suscité par son opposition véhémente, il a atténué sa position, et suggéré que l’Eglise argentine pourrait être disposée à une législation de compromis qui permettrait de créer des unions civiles, sur lesquelles la doctrine catholique est heureusement silencieuse.
Contrairement à ses prédécesseurs, François est apparemment sincèrement attaché au dialogue, à la construction de ponts, à la conciliation et l’arbitrage des différends. Il lui semble important d’apparaître gai, tolérant et cosmopolite. Il a fait des déclarations respectueuses, ouvertes sur les membres et les croyances des autres églises chrétiennes, ainsi que sur les juifs, les musulmans, et même les athées. Mais dans tous les cas où François a tendu la main à ceux qui sont en désaccord avec lui, il l’a fait tout en indiquant qu’il s’agit de sentiments personnels, en dehors des fondements catholiques. Dans la même conférence de presse de l’avion, au cours de laquelle il a fait les manchettes des journaux pour ne pas avoir eu l’air d’accabler les prêtres homosexuels, il a répondu avec dédain à une question sur l’ordination des femmes, affirmant sans ambages : «La porte est fermée. »
Le seul domaine où François peut finir par répondre aux espoirs des réformateurs est sa volonté de nettoyer les éléments peu recommandables de la bureaucratie du Vatican, précisément parce que cela n’a rien à voir avec une volonté de renverser des éléments de la doctrine catholique que les progressistes trouvent tellement exaspérants, inadaptés au libéralisme moderne. La Curie romaine recrute ses membres permanents surtout en Italie, et en tant que corps, elle est devenu le reflet de la corruption et de l’inefficacité de la culture politique italienne. Indépendamment de leurs positions idéologiques, les cardinaux et archevêques (qui proviennent de partout dans le monde) sont en mesure de donner un coup de pouce pour purger ces pathologies.
C’est pourquoi ce nouveau pape, qui possède un bon sens politique, s’est positionné de façon plus agressive sur ce front que sur tout autre – exigeant la responsabilité de la part des bureaucrates du Vatican, nommant un grand nombre de laïcs (et non italiens) dans des commissions qu’il a habilitées à étudier la façon dont l’appareil administratif devrait être remanié. C’est exactement le genre d’étape de bonne gouvernance non-révolutionnaire que l’on pourrait attendre d’un pontife finalement non conflictuel.
Les catholiques progressistes semblent alors devoir être face à une révolution du discours papal. En politique, les élus qui déploient un langage idéaliste finissent souvent par semer la désillusion, provoquer la critique d’hypocrisie, de malhonnêteté et de cynisme, quand, face aux réalités impitoyables de la vie politique, ils ne parviennent pas à faire correspondre des actes à leurs paroles exaltées. (C’est quelque chose que les libéraux américains ont passé leur temps à dénoncer depuis l’élection de Barack Obama en 2008.)
Mais là où l’Eglise est concernée, la rhétorique a une réalité qui lui est propre. L’Eglise a été portée à l’existence, après tout, par un rabbi itinérant dont les paroles ont converti une civilisation à une foi nouvelle et radicale. A notre époque, les dénonciations sévères de déviance doctrinale favorisés par Jean-Paul II et Benoît XVI ont conduit de nombreux progressistes loin de l’Eglise catholique, et leur exode a affaibli l’Eglise à son tour. Les mots de bienvenue de François et ses mains ouvertes ont détourné l’image de la papauté de la décadence sexuelle vers la détresse des pauvres, et si cela convainc les progressistes de rentrer au bercail, il aura fait une très bonne chose pour son Église. Si ses paroles aident également à mettre fin à l’envoi du gros des catholiques pratiquants dans les bras avides du Parti républicain, il aura fait aussi une bonne chose pour la politique américaine.
Même si les gestes de François font les gros titres, l’Église ne pense pas en termes de cycles d’actualités ou de cycles électoraux, mais plutôt en termes de siècles. Un nouveau pape nomme les évêques, les archevêques et les cardinaux qui vont régir l’Eglise de l’avenir et élire à leur tour le prochain pape, qui fera ensuite ses propres nominations, et ainsi de suite, à travers les décennies. Il peut sembler fou aux catholiques progressistes de devoir probablement attendre encore 100 ans pour que leur Eglise déclare que l’utilisation du préservatif est moralement licite ou qu’elle permettre à une femme de célébrer la messe. Mais quelque chose doit mettre en route les roues du mouvement pour le changement, et ce pourrait bien être pour cela que la réforme modeste, mais vitale du pape François finira par être retenue dans les mémoires.
Damon Linker
Article publié le 18 août 2013 dans New Republic
Traduit par Lucienne Gouguenheim
(source : http://www.newrepublic.com/node/114333/)
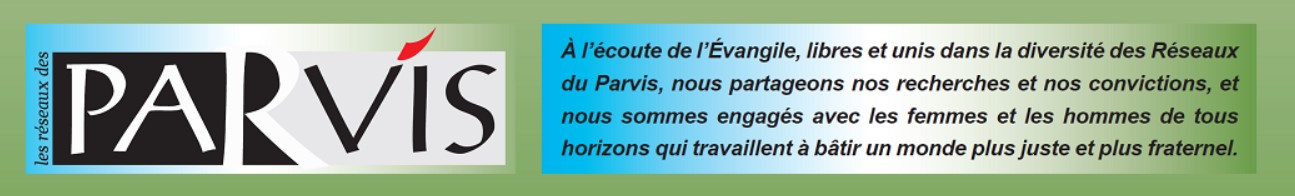
Laisser un commentaire