Quelle est la signification de mon corps ? Quelle part prend-t-il dans la définition de ce que je suis ? Pourquoi les différences physiques ? Comment dois-je comprendre mon désir et celui des autres ? Il s’agit de questions cruciales qui affectent autant nos sociétés que les groupes religieux qui s’y insèrent. La tradition chrétienne a longtemps eu deux notions pertinentes et efficaces pour comprendre l’identité, la différence des sexes et les désirs : la création et la vocation. Dans son élan créateur, et la Genèse a une place importante dans cette compréhension, Dieu nous crée sexué dans un vis-à-vis originel, indépassable et riche de sens, avec l’autre sexe. Mais loin de nous enfermer dans le mâle ou le femelle, Dieu nous appelle également à devenir des hommes et des femmes et à accomplir ainsi notre vocation. Cette dernière est l’endroit où pourrait idéalement se rejoindre la liberté humaine et sa volonté qui reste fondamentalement l’attention pour les autres et les plus petits de nos frères et soeurs. Dans cette tension entre création et vocation, différents états de vie vus comme donnant une signification particulière au sexe (la vie religieuse ou sacerdotale) ou à la différence des sexes (le mariage) doivent contenir les expériences sociales, sexuelles et affectives.
Pourtant la compréhension du monde et des sexes autour du pôle création/vocation, si elle est loin d’avoir perdu toute sa pertinence, se heurte à bien des problèmes aujourd’hui. Que d’incertitudes pour nous après les combats d’émancipation des femmes des années soixante-dix. Les féministes ont bien montré que ce qu’on faisait tenir sur la création, le sexe pour faire court, que ce qui passait pour naturel, était souvent construit et justifiait surtout la subordination. Bien des antiennes du passé ne sont d’ailleurs plus audibles ni dans les communautés chrétiennes ni dans la société. L’essentialisme peine à se renouveler tant il développe des sermons enfermants peu crédibles sur des femmes complémentaires aux hommes. Il établit également des typologies de traits de caractères, d’attitudes ou de rôles qui, à la réflexion, ne sont pas foncièrement masculin ou féminin mais peut-être plus communément et simplement humains. Des hommes peuvent materner et des femmes avoir de l’autorité. La variété sociale des configurations entre rôle social et sexe est immense. Elle échappe à tout schéma binaire et simpliste. Que d’incertitudes pour nous également depuis que l’émancipation des minorités sexuelles tend à dire qu’il n’y a pas de continuité évidente entre l’anatomie et les désirs que portent les individus. Dans nos sociétés, hommes et femmes n’apparaissent plus « naturellement » comme les deux pôles du désir amoureux ou érotique. L’attention grandissante, enfin, que l’on porte également à la trans-identité, l’inadéquation entre une anatomie et ce que perçoit soi-même une personne, nous montre que ce que l’on exhibe toujours comme naturel est loin de l’être dans bien des situations. D’un autre côté, une approche purement constructiviste effraie encore et à juste titre. Tout n’est-il que construction sociale et rapport de force ? Le corps est-il malléable et ne porte-t-il aucun sens en lui-même ? Faut-il renoncer à toute acceptation de la différence des sexes ?
Les études de genre sont nées à un moment de crise de notre histoire commune, lorsque l’essor de l’individu et la valorisation de l’autonomie, le progrès technique, la maîtrise de la fécondité, au premier chef, et l’émancipation des femmes, puis des minorités sexuelles, ont révélé les limites d’une pensée aux accents trop rapidement naturalistes et différentialistes. Le courant des études de genre, bien représenté aujourd’hui dans les différents milieux intellectuels, a ainsi proposé une nouvelle voie. Il propose une démarche de réflexion sur les identités sexuées et sexuelles, répertorie ce qui définit le masculin et le féminin dans différents lieux et à différentes époques et s’interroge sur la manière dont les normes se reproduisent jusqu’au point de paraître naturelles et potentiellement sources d’injustice.
Comment le recevoir dans un cadre de pensée chrétien ? Quelle place pour une éthique chrétienne du genre ? Les études de genre appellent à un questionnement qui peut être déstabilisant voire inquiétant car elles ébranlent l’éthique et la doctrine traditionnelles. On peut les refuser, les rejeter, les combattre ou bien les voir comme une chance pour penser une pratique de l’Évangile à notre époque. Dans les années soixante-dix, des théologiens étaient prêts à voir les éléments les plus déstabilisants des savoirs contemporains d’alors comme positifs voire comme autant de chances
pour renouveler notre compréhension ,de la foi et de son intelligence. Faut-il réhabiliter cette méthode ? Plus concrètement, les outils d’élucidation de la condition humaine qu’offrent les études de genre peuvent-ils être intéressants ? Ne nous montrent-elles pas combien, avant de tout miser sur la différence des sexes, il faut accepter également son devenir dans une histoire ?
Pourquoi y a-t-il une vivace opposition chrétienne au concept de genre ?
L’année 2011 fut marquée par une polémique d’une rare intensité dans le milieu scolaire. Elle surgit à l’occasion de la révision d’un programme de biologie pour les classes de premières. Le Secrétariat National de l’Enseignement catholique puis la Conférence des Évêques catholiques français se sont émus de l’introduction de la « théorie du genre » dans les nouveaux manuels produits par les éditeurs scolaires. Ils ont appelé les professeurs et les parents d’élèves à la plus grande vigilance. À leurs yeux les nouveaux ouvrages auraient été contaminés par une idéologie cherchant à subvertir les savoirs biologiques en matière de différence des sexes et sexualité. Cette dernière cautionnerait une approche trop compréhensive des comportements homosexuels et de la trans-identité. Un champ d’études relevant d’habitude du cadre plus confidentiel et feutré des débats d’idées académiques s’est ainsi retrouvé sur le devant de la scène publique et médiatique, suscitant des articles de presse, des émissions de télé et de radio voire des questions publiques au gouvernement de la part de députés. Du côté des chrétiens, même des milieux plus ouverts, très peu de réactions positives, la gêne et la méconnaissance semblant l’emporter sur la compréhension des études de genre.
Cette opposition de l’institution catholique aux études de genre est, rappelons- le, plus ancienne et a déjà une histoire. Cette dernière prend surtout pour cadre les instances internationales de l’ONU et de l’Europe. En 1995, lors de la Conférence mondiale sur les femmes à Beijing, le terme genre entre dans les documents de travail et le programme d’action final. La notion de genre apparaît alors comme le meilleur moyen d’approcher de manière dynamique la question de la condition féminine. Avec une approche par le genre, il ne s’agit plus seulement d’un problème qui ne concerne que les femmes mais qui s’insère dans une réflexion plus générale sur la répartition sociale des activités ainsi que les rôles historiquement construits qui assignent des places aux femmes et aux hommes. Le Saint-Siège réagit pourtant vivement : « l’existence d’une certaine diversité des rôles n’est nullement préjudiciable aux femmes, pourvu que cette diversité n’ait pas été imposée arbitrairement mais soit l’expression de ce qui est propre à la nature d’homme ou de femme » (Rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, New York, Nations-Unies, 1996, p. 173). Au même moment, l’Église catholique romaine rappelle que le choix d’hommes par le Christ pour être ses apôtres n’est pas lié à un conditionnement social ou à un contexte historique et géographique particulier. Ce choix révèle bien quelque chose de la foi déposé dans la nature humaine qui ne pourrait être remis en cause. Le ministère sacerdotal masculin ne peut être vu comme un rôle socialement hérité aux yeux de Rome et on comprend bien que le concept de genre inquiète dans le sens où il appelle justement à interroger la différence des sexes et les évidences de la nature.
L’idée proprement catholique qu’il existe un complot idéologique cherchant à s’opposer à la famille traditionnelle et dont la théorie du genre serait le cheval de Troie qu’il faut combattre remonte clairement aux années quatre-vingt. Elle n’a eu de cesse de se renforcer depuis. Issue des milieux de réflexion sur les droits humains, la notion d’« identité de genre » émerge au début des années 2000. Définie comme « faisant référence à l’expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres », l’identité de genre comme concept juridique tendrait à intégrer dans la protection juridique à laquelle a le droit un citoyen non seulement l’orientation sexuelle mais également la trans-identité dans ses différentes dimensions : du travestissement à la modification chirurgicale. Dans les chemins propres du droit pris par nos sociétés, homophobie et transphobie tendraient à devenir des motifs aggravants de discrimination ou de diffamation à l’instar du racisme. Cette notion d’identité de genre a été transposée en droit européen dans le rapport d’Andreas Gross adopté par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe au printemps 2010. IntituléDiscrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, il a été vertement critiqué par les nonces et des organisations familiales catholiques. Deux intelligences du monde contemporain entrent de plus en plus en confrontation. L’une classique selon laquelle il existe des normes naturelles qui ne relèvent pas du périmètre du droit, ne sont pas négociables et ne peuvent donc pas être changées. Il s’agit principalement aujourd’hui pour l’institution catholique des droits des individus à maîtriser leur fécondité ou aux personnes de même sexe à accéder au mariage. De l’autre, une nouvelle vision du corps et de l’intime où des règles, si elles sont démocratiquement élaborées et acceptées, peuvent évoluer.
Si le genre des sociétés change, que les activités et les attendus sociaux se redistribuent entre hommes et femmes, que les jugements éthiques se déplacent devant certains comportements, cela veut-il pour autant dire que tout se vaut, que cela est juste et qu’il n’y a plus aucun critères de valeur à avoir devant l’évolution de nos sociétés ? Aujourd’hui, nous pouvons prendre comme critères importants ceux de l’humanisme et le développement des droits humains : l’égalité, la dignité, la réciprocité et le respect de l’autonomie de chacun-e. Ces derniers restent fortement compatibles avec l’Évangile. Le Réseau Européen Églises et Libertés dont font partie les réseaux du Parvis et FHEDLES a ainsi soutenu le rapport Andreas Gross au nom de son attachement inaliénable aux droits des personnes homosexuelles ou trans-identitaires à être protégées et acceptées dans la société.
Peut-on dénaturaliser l’approche de la sexualité humaine ?
Pendant longtemps, l’appréhension sociale et intellectuelle de la sexualité est en effet passée par le prisme du genre. Ce qui définissait un homme et une femme, c’était également et indissolublement l’exercice exclusif d’une sexualité hétérosexuelle. Au XIXème siècle, chez Proust, les homosexuels masculins sont encore vus comme des personnes chez qui une âme de femme est prisonnière d’un corps masculin. Sexe, genre et sexualité ne sont pas conceptuellement séparés. Les trois coïncident même très bien dans ce qu’on désigne encore un sexe, fort ou faible, beau ou viril, et tout écart aux normes de son sexe est vu comme subversif ou pathologique, comme un désordre qu’il faut nécessairement combattre ou juguler car« contre-nature ». La psychanalyse freudienne, sûrement encore prégnante aujourd’hui dans notre façon de penser, ne dépasse pas ce cadre, elle lie fortement la différence des sexes à la différence des générations, ainsi l’attirance pour l’autre sexe à la maturité psychique. On ne pourrait passer à l’une que par l’autre, on nepourrait s’accomplir comme homme et femme que par l’affectivité et la sexualité avec une personne d’un autre sexe.
Si l’approche naturaliste de la sexualité a été longtemps la nôtre ici en Occident, il n’est pourtant pas dit qu’elle englobe la variété des groupes humains ou des situations historiques ; c’est aussi sûrement là l’apport majeur des études de genre. Elles nous révèlent que des configurations sociales sexe/genre laissent une place à des pratiques homosexuelles, des travestissements rituels ou des organisations sociales de comportements sexuels non reproductifs. Il existe aussi des sociétés passées, comme dans la Grèce Antique, où ce n’est pas la différence des sexes qui organise la sexualité mais la façon de gérer le plaisir ainsi qu’une morale du contrôle de soi. Les débats actuels autour de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe donnent souvent lieu à des condamnations de l’homosexualité qui s’appuient sur des fausses évidences naturalistes : « c’est contre nature ! », des anthropologies péremptoires : « hors du couple homme-femme, rien de bon ! » et des psychologies catégoriques : « les homosexuels sont immatures ! » et bien peu sur l’Évangile finalement. Et pour cause ! On serait sûrement bien en peine d’y trouver un élément explicite pour réprouver moralement l’homosexualité. Le Christ n’est pas venu pour donner des fondements anthropologiques aux sociétés humaines mais pour appeler chacun à la conversion, à vivre en accord avec Dieu, à rendre plus juste son désir et à renoncer à une certaine forme de convoitise[i]. Pourquoi l’objet d’un désir serait-il le critère supérieur au processus d’humanisation qui peut toucher ce désir ? Quelle place donnée aux nouvelles revendications identitaires des minorités sexuelles dans la société et dans les communautés chrétiennes ? Cette impérieuse question ne se résoudra sûrement pas par une réhabilitation artificielle de l’anthropologie passée.
Le genre comme moyen de comprendre ceux et celles qu’on subordonne
L’intuition d’une nature qui cache un construit culturel fonde un enjeu éthique d’émancipation dont bien des aspects peuvent être vus comme chrétiens. On connaît tou-te-s le mot du philosophe Blaise Pascal : la culture cette seconde nature. Des traits pris comme évidents et naturels peuvent être le fruit d’une acculturation progressive, si évidente, qu’on les naturalise en retour. Le sociologue Pierre Bourdieu avec son concept d’habitus avait dit quelque chose d’un peu similaire : la société produit dans le même mouvement de l’évidence et de la hiérarchie. S’il y a norme il y a en effet pouvoir et un enjeu de libération.
Dans les études de genre, il y a même très peu au final de toute-puissance de l’individu mais une petitesse somme toute très évangélique. On n’endosse pas un genre comme un costume au théâtre, selon son bon plaisir et son caprice du moment, et même chez une philosophe, sûrement à tort très décriée comme Judith Butler, avant d’être unsujet libre on est déjà produit sujet par d’autres. Dans l’évidence d’un regard, par la répétition d’un geste, par l’incorporation longue, permanente et répétée d’un geste ou d’une posture, le sujet est produit avant même d’en prendre conscience et de composer éventuellement avec. Le fait même que des expressions comme femme virile ou homme efféminé existent dans notre langue témoigne de la faiblesse d’une pensée qui s’arrêterait à l’évidence naturelle des sexes. Si nous n’étions vraiment que mâle ou femelle, il n’y aurait de féminin ni de masculin. C’est que les études de genre nous invitent à réfléchir selon un modèle beaucoup plus déstabilisant : personne ne s’accomplit véritablement dans son genre, chacun reste en-deçà du « masculin » et du « féminin », dont on serait bien en peine de donner une définition simple et arrêtée. Nous sommes tous dans une performance de genre plus ou moins consciente, plus ou moins aliénante, et plus ou moins satisfaisante pour nous-mêmes et les autres.
Une approche par le genre permet en effet de placer sa compréhension du côté de ceux qui souffrent de la nature pour conforter un rapport de pouvoirs déjà existant et bien souvent ininterrogeable : femmes, minorités sexuelles,personnes qui relèvent des « subjectivités subalternes »[ii] et ne sont pas l’étalon des discours sur la société. En cela, études de genre et théologie de la libération concorderaient sur leurs objectifs : se mettre du côté de ceux qui ne sont pas qualifiés pour produire les règles qui les dominent. Il y a une évidence du pouvoir qui se naturalise et permet de disqualifier ceux et celles qui ne s’y conforment pas. Les groupes religieux ne sont-ils pas eux-mêmes dans les mêmes logiques de contrôle des déviances de genre ? Lorsqu’un magistère masculin affirme que les femmes doivent être tenues à l’écart des ministères, ne neutralise- t-on pas la parole des premières intéressées à mettre des mots sur une vocation ? Lorsqu’on appelle actuellement les soeurs américaines de la Leadership of Women Religious Conferenceà adopter une posture plus conforme à la dignité de leur sexe, c’est-à-dire la modestie et la non remise en cause des normes pastorales ou des écrits doctrinaux produits par des hommes, que dit-on en sous-main du genre féminin catholique ? Comment cette situation nous éclaire-t-elle sur l’exercice de l’autorité du masculin sacerdotal ?
On pourrait avancer que le terrain sociétal, l’égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations dont sont encore victimes les minorités sexuelles, constitue beaucoup moins l’enjeu d’une théologie de la libération que le terrain social des rapports socio-économiques Nord-Sud ou de la lutte contre la précarité qui affectent nos sociétés occidentales. Outre qu’il n’est pas vraiment établi que les logiques d’exclusion différent véritablement, quand elles ne se cumulent pas parfois (pensons particulièrement aux femmes des pays en développement), il est intéressant de noter aujourd’hui que les communautés les plus avancées sur la pastorale des minorités sexuelles sont aussi celles souvent les plus sensibles aux questions économiques. Elles ne développent pas tant un appel à constituer des « gay churches » que des lieux de partage « inclusifs ». Saint-Merry ou le temple de la Maison Verte à Paris, qui se présente comme « une coalition de minoritaires », de nombreux lieux sûrement dans les régions, se veulent ainsi ouverts aux personnes autant en situation de marginalités socio-économique ou socio-culturelle qu’issus des minorités sexuelles. Comment tenir la corde entre une reconnaissance de chacun dans sa spécificité et sa souffrance propre et le maintien de groupes ouverts à tou-te-s ? Comment faire entrer ce questionnement dans nos communautés.
N’ayons pas peur du genre !
Dans une revue de théologie morale, le frère dominicain Laurent Lemoine se
demande si au final la peur des études de genre n’était pas un peu un « pétard mouillé » : « d’aucuns présentent les gender studies comme une idéologie historiquement aussi dangereuse que le marxisme ! Est-ce jouer les Cassandre que de le prétendre ? (….) De fait la galaxie du gender propose aux aventuriers un voyage indéfini fait de permanentes déconstructions socio-culturelles de soi (…) qui n’est pas sans écueils mais qui ne mène pas nécessairement au naufrage ». Sans pour autant souscrire à un optimisme béat à leur égard, il se demande si les études de genre ne peuvent pas nous aider à comprendre comment le sujet parle de lui-même et produit son identité à l’instar des personnages de l’Évangile : « comme Zachée, la femme adultère, le jeune homme riche, l’aveugle-né sont des individus à l’identité inachevée, errante qui se cherche, qui a besoin de se dire, d’être parlée à quelqu’un, Jésus en l’occurrence, qui les aide à atteindre la vérité d’eux-mêmes qu’ils possèdent sans le savoir malgré les voies sans issue empruntées jusqu’alors. Jésus est plutôt discret en matière d’éthique sexuelle. Cela a été maintes fois souligné. Elle [la galaxie du gender] met d’abord l’accent sur la recherche de vérité (…) Elle place la quête de soi, la quête d’identité sur une toile de fond très vaste dont la sexualité, pour être importante, n’est qu’un aspect, pas un détail bien sûr mais un aspect. Jésus a conduit un groupe minoritaire qui s’est constitué à sa suite sur la base d’une subversion identitaire de ses membres qui ont quitté leur foyer, leur mode de vie, leurs repères sociaux, éthiques et culturels. La subversion éthique apportée par Jésus conduisait à affirmer dans sa vie ceci (…) “ le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat ” ».
Anthony Favier
Références bibliographiques
– Béraud Céline (février 2011) : Quand les questions de genre travaillent le catholicisme, Études, 414/2, pp. 211-221
– Bereni Laure, Chauvin Sébastien et Jaunait Alexandre (2008) : Introduction aux gender studies, Bruxelles, De Boeck, 247 p.
– Fassin Éric (2010) : « Les forêts tropicales du mariage hétérosexuel, loi
naturelle et lois de la nature dans la théologie actuelle du Vatican », Revue d’éthique et de théologie morale, n°261, pp. 201-202
– Lemoine Laurent (2011) : « Questions nouvelles par les identités sexuelles d’aujourd’hui », Revue d’éthique et de théologie morale, n°263, pp. 9-29.
Vivre c’est devenir
Sexe, genre et identité
Approche constructiviste
Tout le monde s’accorde, même les plus opposants aux analyses de genre, à reconnaitre a ce type d’approche une pertinence certaine dans la mise en valeur des injustices et des discriminations entre les hommes et les femmes. Tony Anatrella(1) déclare que l’affirmation de l’égalité entre les hommes et les femmes représente un progrès considérable dans le monde et notamment là où des cultures infériorisent et méprisent les femmes a commencer par les fillettes. Mais très vite le soupçon apparait : « Siles études du “gender” ont eu le mérite de mettre en lumière des inégalités et des injustices sociales à l’égard des femmes, très vite ces études sociologiques se sont transformées en mouvement idéologique et de combat entre les hommes et les femmes. »
Les analyses de genre (gender studies) sont accusées de se durcir en « théorie du genre » qui prônerait le libre accès a une identité construite et rejetterait tout donne d’ordre biologique, appelé naturel(2). On pourrait de ce fait choisir son sexe ! Cette éventuelle fluidité du sexe panique la hiérarchie catholique et les milieux conservateurs. Il existe un malaise certain par rapport à une soi-disant théorie du genre soupçonnée de supprimer la différence sexuelle. Nous faisons l’hypothèse que, composée d’hommes masculins, c’est la masculinité qui se sent menacée. L’obligation du célibat qui oblige à se garder des femmes et une certaine morale sexuelle qui a longtemps assimilé le plaisir au péché ne favorisent pas la construction d’une identité sexuelle sereine(3). La notion de genre a l’avantage de rendre visibles les hommes comme individus sexués. Ce qui a permis une émergence d’une histoire des hommes, de l’étude de la construction de la virilité, des souffrances des hommes(4). Genre et constructivisme apparaissent liés dans la crainte et le rejet qu’ils provoquent. Mais qu’est-ce que le constructivisme ?
Qu’est-ce que le constructivisme ?
Cette philosophie déjà ancienne(5) ne nie pas la réalité (en l’occurrence les données appelées naturelles), mais dit que nous ne la connaissons que par l’expérience que nous en faisons et que celle-ci est toujours relative à notre culture, à notre situation dans un monde précis, à notre environnement, dépendante de notre regard propre, de nos expériences passées… On ne peut donc jamais tabler sur une réalité qui serait totalement objective. Elle n’est pas non plus totalement subjective, car nous faisons tous la même expérience et rencontrons la même réalité. Mais nous ne pouvons prouver l’objectivité de nos perceptions. Il y a bien un réel qui résiste, mais auquel nous n’avons accès que par la perception et l’organisation que nous en faisons. Einstein dit que c’est la théorie qui détermine ce qu’on peut observer. Sans théorie, sans hypothèse, nous ne voyons rien.
De plus, quand on observe la réalité, on modifie celle-ci. C’est un renversement de la façon habituelle de penser dans laquelle la réalité existerait indépendamment de nous. C’est souvent ainsi que l’on perçoit la création de l’univers par Dieu : une réalité donnée dont l’homme découvre les lois naturelles, alors qu’on pourrait parler de co-création. Ajoutons que nos efforts de connaissance créent une réalité, que l’on peut être tenté de considérer comme unique et définitive, naturelle pourrait-on dire. C’est contre cette absolutisation de notre vérité que le constructivisme met en garde. Nous construisons donc une image de la réalité, une vision du monde. Il s’agit d’une image globale qui s’intègre dans un ensemble et possède sa cohérence. Une telle construction est aussi une construction de sens. L’être humain ne peut pas vivre dans le non sens, dans l’absurdité, sans tomber dans la folie. D’où l’importance de passer du chaos au cosmos (Piaget).
Cette image du monde n’est pas le monde, mais nous n’avons aucun moyen de connaître le monde autrement que par les images que nous nous en faisons et que nous soumettons à un processus de vérification en les confrontant aux images des autres, aux faits et aux évènements. Ce processus peut les confirmer car elles s’avèrent pertinentes ou les rejeter comme inadéquates ou encore nous laisser dans l’indécision. En logique, il s’agit du vrai, du faux ou de l’indécidable.
Alors la personne humaine est-elle un être uniquement construit culturellement et en particulier en ce qui concerne le corps sexué, l’identité sexuelle et les relations sociales ? Le même processus que décrit précédemment est à l’oeuvre dans la définition de nous-mêmes et des autres. Là encore, nous n’accédons à notre moi, à notre identité que par un processus de communication avec les autres. S’est-on parfois demandé pourquoi nous passions autant de temps à des conversations et des échanges au contenu informatif pratiquement nul, comme les conversations sur la pluie et le beau temps ? C’est parce que nous avons besoin de savoir qui nous sommes et nous passons donc notre temps à proposer à ceux qui nous entourent une image de nous-mêmes et nous attendons qu’elle soit confirmée. A la limite, peu importe le contenu des échanges, c’est la relation qui s’instaure entre les interlocuteurs qui compte. Cependant, lorsque l’échange porte sur des sujets graves qui nous tiennent à coeur, notre image peut en recevoir une confirmation valorisante ou un rejet cinglant.
Dans ce dernier cas, il nous faut alors en proposer une variante. Il arrive aussi que notre propos ne soit pas perçu, c’est comme si nous n’existions pas. Si cette situation est habituelle, surtout chez un être en formation, elle aboutit à de graves troubles de la personnalité. Le plus souvent, heureusement, on se construit grâce à la confirmation ou au rejet de son image. On agit de même pour autrui. Non seulement toute parole prononcée, mais toute attitude, tout comportement prend une signification de confirmation, de rejet ou de déni. C’est grâce à ce processus incessant de communication que nous sommes ce que nous sommes. Privé d’échanges, privé d’environnement humain, un être ne peut se construire et devenir vraiment humain. On n’existe pas tout seul, on n’a pas de réalité en dehors du regard de l’autre, sans sa reconnaissance.
C’est là que Simone de Beauvoir avait raison : « On ne naît pas femme, on le devient ». Et elle ajoutait « sous le regard d’un homme ». Son raisonnement omettait la réciproque : « On ne devient homme que sous le regard d’une femme ». On ne s’identifie que dans un jeu subtil entre le Même et l’Autre, a la fois semblable à autrui et différent de lui. On ne prend conscience de son sexe que devant le sexe de l’autre. Les identités s’élaborent au sein de systèmes relationnels dont les éléments sont en interdépendance, comme peuvent l’être le masculin et le féminin. Si, effectivement, l’identité est construite, elle n’est pas pour autant créée ex- nihilo. Le sexe comme le genre, comme l’orientation sexuelle et comme bien d’autres choses encore qui constituent l’être humain sont des matériaux de base de notre identité. On ne choisit pas tout. On classe, on organise, on donne du sens. Ce n’est pas une liberté débridée. Chacun, chacune a ses contraintes. Il, elle, n’a choisi ni son sexe, ni son orientation sexuelle, ni ses parents, ni son environnement, ni son milieu social, ni sa culture, ni sa race. Et c’est avec tout cela qu’il faut faire. La personne humaine est plus que son sexe. Il faut « prendre garde à ne pas assimiler l’individu à son sexe biologique »(6). De plus, l’environnement ne cesse de changer avec l’âge et les circonstances de la vieobligeant à endosser de nouvelles identités. Ce processus de construction dure toute la vie. On pense que c’est dans l’enfance et l’adolescence que ce processus est particulièrement actif et qu’à l’âge adulte il s’arrête. Adolescens est un participe présent désignant quelque chose en train de se faire, alors qu’adultusest un participe passe, c’est fait, c’est terminé. Or il n’en est rien. S’il est vrai que ce processus est à son apogée dans les jeunes années, son arrêt signifie la mort. L’être humain ne cesse de devenir humain, c’est l’anthropolescence, véritable nature de l’humanité. D’un côté, nous avons des matériaux qui contribuent à nous constituer, mais de l’autre, à partir de ces données brutes, il y a la construction personnelle dont nous sommes responsables.
L’image de Dieu (7)
Le premier commandement (Ex 20, 3-5 et Dt 5, 6-8) interdit les images de Dieu : « Tu ne te feras aucune image sculptée… Tu ne te prosterneras pas devant ces images ni ne les serviras. » Or comment accéder à Dieu sans l’intermédiaire des images ? Comme l’homme se construit et construit son monde,il construit aussi son Dieu. L’histoire de Dieu reflète l’histoire de l’homme. Jean Onimus(8) montre comment, selon son évolution, l’humanité est passée du dieu de la tribu aux dieux cosmiques, puis au dieu absolu, abstrait, évanescent, aliénant, libérateur, de celui des mystiques à celui du mal en passant par le Dieu horloger et le Dieu du bien. Cette construction, d’image en image, n’est pas terminée. De quel Dieu avons-nous besoin aujourd’hui ? Quel sera le Dieu de demain ? Comment cette succession d’avatars divins est-elle conciliable avec l’interdiction de faire des images de Dieu ?
La encore, le constructivisme peut intervenir. En effet, un adjectif attire l’attention dans ce premier commandement, c’est le mot sculptée. Lorsqu’elle est sculptée, l’image accède à un niveau de fixité et de rigidité. L’image est devenue plus réelle que le réel. Elle est devenue une idole. L’idole n’est pas seulement la sculpture de bois ou de métal (le Veau d’or), mais c’est notre idée de Dieu, absolutisée au point de la prendre pour Dieu lui-même et de nous prosterner devant elle. Ma propre réalité, celle de l’autre, celle du monde échappent aux images dans lesquelles nous voudrions l’enfermer et la cerner. Le réel est toujours autre que ce que j’en saisis. A fortiori, Dieu est le tout-autre sur lequel je ne peux mettre la main.
Le Veau d’or nous fait sourire dans son inadéquation à représenter Yahvé, et pourtant nos images de Dieu sont aussi de bien piètres représentations. Elles ne peuvent devenir chemins vers Dieu que dans la mesure où elles acceptent d’être frappées d’indécidabilité. Plus nous avons peine pour nous faire une image de Dieu, cohérente, donnant sens à nos existences, plus il est difficile de l’abandonner. Lorsque des circonstances où de nouvelles connaissances théologiques ou scientifiques viennent remettre en cause notre image de Dieu, nous nous sentons envahis par le doute, par l’absurdité de l’existence, ébranlés dans nos convictions les plus profondes. Il est compréhensible que nous nous accrochions alors à nos images obsolètes et sécurisantes et que nous les légitimions par la fidélité ou l’obéissance. Mais nous sommes entrés dans une attitude d’idolâtrie. La vérité, y compris celle de Dieu, n’est pas à trouver parce qu’elle existerait quelque part, elle est à faire au cours d’un processus jamais terminé. C’est peut-être au coeur de l’épreuve, abandonnés de Dieu (de notre image de Dieu ?), lorsque nous lâchons prise, emportes dans l’indécidable, que le Dieu vivant et insaisissable est le plus proche de nous.
Apprendre à surfer
De tout temps, on a cherché à conforter son identité : costumes régionaux, vêtements féminins et masculins très différenciés, signes distinctifs selon la classe sociale ou l’appartenance, badges, insignes… etc. L’évolution du monde a bousculé nos identités, de race, de milieu social, de genre, de sexe. Il y a un brassage nouveau des populations, des religions, des classes sociales ou des sexes, une répartition nouvelle des tâches et des rôles. Les anciens points de repères ne conviennent plus. Faut-il alors renforcer des identités menacées ou entrer courageusement dans un processus de construction et de reconstruction de l’image de soi ? Les identités qui s’élaborent ainsi sont plus riches et plus souples. Nous ne sommes plus enfermés dans une identité univoque. Dans la logique exclusive du ou bien / ou bien, qui rend incompatibles plusieurs appartenances, ne faut-il pas introduire la logique du et / et où restent en tension des rôles ou des valeurs différentes, voire divergentes ? En passant d’une logique à l’autre, on atteint la logique multidimensionnelle et complexe qui s’énonce ainsi : soit ceci, soit cela, soit les deux(9). N’est-ce pas à un tel changement logique que nous sommes appelés ? Sachant utiliser nos diverses appartenances, gardant en tension le féminin dans le masculin et le masculin dans le féminin, apte à remplir plusieurs rôles et à en changer selon les circonstances, ouvert à des valeurs nouvelles.
Ce mouvement perpétuel, cette fluidité, cette inconsistance, cette absence de point fixe peut donner le tournis et inciter à se replier sur une proposition identitaire qui a le mérite de l’ancienneté. Une fois une représentation globale établie et considérée comme satisfaisante, on peut avoir tendance à la rendre intouchable ; nous avons enfin établi le vrai et ce faisant nous prenons la représentation pour la réalité.
Si des éléments viennent contredire cette vérité, on peut préférer ne pas les voir ou les déformer pour les faire tenir dans notre vision du monde. Les contradictions entre la réalité telle qu’elle est et telle qu’elle devrait être en fonction de nos prémisses sont alors utilisées pour renforcer notre représentation.
L’opinion se durcit et se transforme en dogme : doxa devient dogma. On s’acharne d’autant plus à défendre son image que celle-ci correspond à la réalité communément admise dans son groupe de référence. Se trouver en harmonie avec son groupe ou sa culture est bien aussi important que le témoignage de ses sens. On fait alors la sourde oreille, on se voile la face, on fait la politique de l’autruche. Condamnés à ne pouvoir nous passer d’images pour appréhender la réalité, nous avons aussi à conserver l’image, son statut d’image, c’est-à-dire de représentation signifiante, mais ne portant pas toute la signification, image pertinente pour aujourd’hui, pour telle personne, pour telle culture scientifique ou autre, mais sans pertinence pour demain ou pour d’autres cultures. Il nous faut alors changer nos prémisses. C’est là où il faut redonner à l’indécidable sa fonction. En effet, il est inconfortable de vivre dans l’indécidabilité, sorte d’oscillation entre le vrai et le faux, entraînant le suspens de l’action. Qui suis-je ? Que dois-je faire ? Mais c’est aussi l’ouverture de la recherche, la source de la créativité et d’une liberté possible(10).
L’accès à la liberté ouvre sur une énorme responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. La construction de soi est permise par le regard des autres et celle des autres dépend de notre regard. Nous ne sommes pas loin de la règle d’or : Agis envers les autres comme tu voudrais qu’ils agissent envers toi.
Alors que le constructivisme est accusé de supprimer les points de repère, celui-ci n’en est pas dépourvu pour autant : « la tolérance, le pluralisme, la distance qu’il nous faut prendre à l’égard de nos propres perceptions et valeurs pour prendre en compte celles des autres(11) » ; la responsabilité, car nous sommes en grande partie responsables de notre image et de celle des autres ; si notre construction n’est pas pertinente, nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous mêmes.
Un autre repère consiste à agir toujours de manière a augmenter le nombre des choix. Tout ce qui enferme dans un rôle, dans un genre, dans un sexe, dans une identité est contraire à l’épanouissement des potentialités de la personne. Ouvrir l’éventail des possibles, se rendre capable de modifier des significations qui n’ont plus de pertinence pour aujourd’hui. Certes, il s’ensuit une instabilité, une précarité, une remise en question permanente qui font partie de notre monde complexe postmoderne. Il s’agit de rester en équilibre sur cet océan mouvant en développant notre réseau d’interaction, notre potentiel relationnel, notre capacité de réflexion.
L’image du surfeur s’impose(12). Au lieu de suivre un parcours balisé, celui-ci se laisse porter par la vague. Sous l’apparente désinvolture du geste, se cache une force intérieure très grande qui n’est pas inquiétée ou déstabilisée par ce qui surgit, mais qui utilise au contraire ce qui se présente, pour une plus grande vitesse et un plus grand plaisir. Si, par hasard, le surfeur est déséquilibre, il montre alors toute sa capacité a encaisser, sans être démoli. Utilisant encore une fois les éléments, il refait surface et recommence pour une glisse encore plus belle.
Pour des chrétiens, cette démarche n’est pas sans rappeler celle de la foi. La foi ne commence-t-elle pas lorsqu’il n’y a plus de chemin ? Elle demande d’avancer encore, de sauter en fermant les yeux sans savoir s’il y aura de la terre ferme pour se recevoir, et sans doute n’y en aura-t-il pas. Parfois, fugitivement, nous avons expérimenté que même sans terre ferme nous ne tombions pas. Comme Pierre marchant sur les eaux : c’est bien la foi qui le maintient, dès qu’il revient a la réalité raisonnable, il sombre(13).
Alice Gombault (mai 2013)
1-Tony Anatrella, Conférence à Rome, 23 novembre 2011.
2-Cf. Jacques Arènes, psychanalyste chrétien, comme Tony Anatrella. Ils appuient tous deux de leur compétence la pensée du magistère catholique, défavorable au genre.
La tendance actuelle va plutôt dans le sens d’un “constructivisme” ou les thèmes lies à la sexuation sont considérés comme des représentations culturelles qui n’ont rien à voir avec une quelconque donnée naturelle. In « La question du genre », Etudes, janvier 2007.
3– Cette fragilité masculine (peut-être une peur archaïque de la castration ?) est sensible dans le document « Théorie du genre et SVT » proposé par la Fondation Jérôme Lejeune, qui montre, en couverture, un petit garçon penché vers son sexe, pour bien s’assurer de son existence, accompagné des interrogations suivantes : « Pas un homme ? Moi ? Alors ? Quoi ? ».
4- Françoise Thébaud, in revue Historiens et Géographes.
5– Vico, XVIIIe siècle, philosophie reprise par Kant et, parmi les contemporains, Piaget, Edgar Morin et autres.
6– Sylviane Agacinski, reprenant la pensée d’Aristote. Femmes entre sexe et genre, Seuil, 2012, p. 72.
7– Article paru dans Parvis n°25, 2005.
8- Jean Onimus, Le destin de Dieu, Éd. L’Harmattan, 2003.
9– Edgar Morin.
10– Henri Atlan, Tout, non, peut-être : éducation et vérité, Éd. Seuil, 1991.
11– L’invention de la réalité, Contributions au constructivisme, dirigé par Paul Watzlawick, Seuil, 1988, p. 344.
12– Alice Gombault, « Les identités bougent », La Croix, 8 novembre 1999.
13– Alice Gombault, « Quels points de repère ? », La Croix, 6 janvier 2004.
[i]Voir La sainteté pour tous, billet du blog Baroque et fatigué, 4 octobre 2012.
[ii] Selon l’expression de la philosophe Gayatri Chakravorty Spivak.
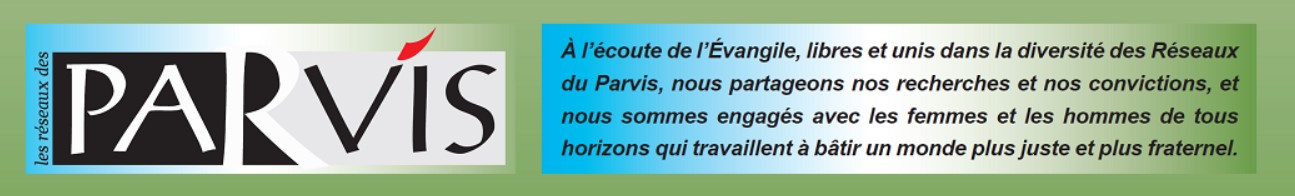
Laisser un commentaire